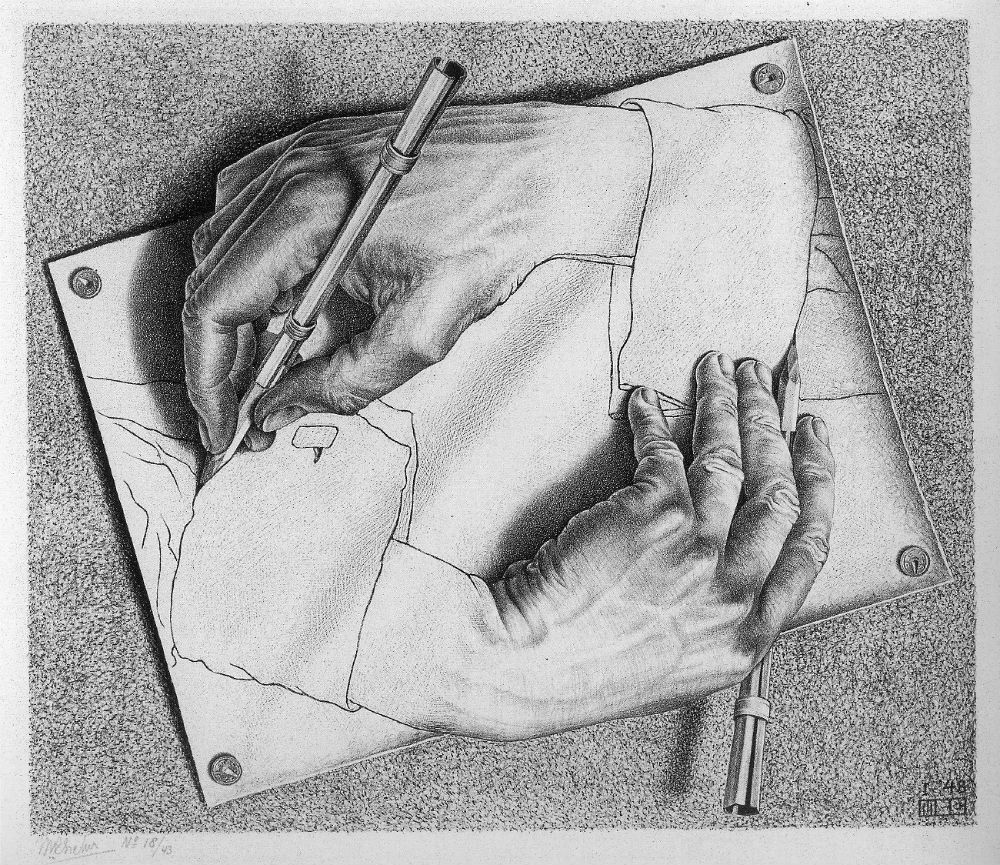
Lorsqu’une étude se porte sur des systèmes organisés dans lesquels se meuvent les flux, les rapports de force et les contradictions, il arrive assez souvent que l’on fasse appel aux métaphores de la vie ou de l’organisme. Or si les métaphores peuvent avoir un rôle constitutif dans le développement des idées et de la pensée scientifique, il reste qu’elles ne reflètent pas toujours les articulations conceptuelles propices à l’émergence de nouvelles perspectives, surtout dans l’optique d’une connaissance tenant compte de ses ouvertures et de ses antagonismes. C’est ce qui rend nécessaire le recours à la pensée complexe, en ce qu’elle permet justement de mettre en avant dans le phénomène de la vie, des principes investissant le champ des contradictions et des complémentarités. Suivant le paradoxe de l’un et du multiple, du tout et des parties, la complexité dans ce qu’elle a de favorable à une intelligibilité de la vie, nous invite à interroger ce qu’il adviendrait quant à l’art et de l’esthétique : que peut en effet la pensée complexe lorsque l’on considère des œuvres d’art ? Si la vie et l’esthétique devaient partager certains principes, s’ils devaient avoir un mode de fonctionnement commun, comment cela se traduirait-il ?
Ainsi, nous appuyant sur la complexité notamment à partir du second volume de la Méthode d’Edgar Morin, sous-titré La vie de la vie[1], il s’agira de mettre en avant les antagonismes inhérents au phénomène de la vie, dans l’optique de les confronter au régime écologique dans lequel s’inscrivent les œuvres d’art ; ce qui en outre nous conduira à questionner ce que pourrait être l’esthétique dans sa proximité à l’égard des mécanismes de la vie.
Introduction à la pensée complexe
La pensée complexe proposée par la Méthode entreprend de considérer tout objet, toute science, toute approche dans un rapport d’unité, tout en conservant à l’esprit un souci d’ouverture. Ainsi, se poser la question « qu’est-ce que la vie ? », ou se poser la question « qu’est-ce que l’esthétique ? », est omettre la nature diverse, contradictoire, événementielle, mais aussi subjective, connective et sans cesse portée vers l’inconnu, que suppose toute complexité. Penser la vie, est aussi penser la brèche qui lui est inhérente, c’est-à-dire « la faille qui brise et fait éclater ce que l’on croyait monolithique et stable. Mais c’est aussi l’enveloppe qui se déchire et laisse échapper son contenu, en même temps qu’elle permet à de nouveaux contenus d’affluer en son intérieur. »[2]
Mais qu’est la pensée complexe, et plus précisément, la pensée complexe de la vie ? On ne peut prétendre répondre de façon exhaustive, comme l’écrit Edgar Morin : « Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. […] La complexité ne saurait être quelque chose qui se définirait de façon simple et prendrait la place de la simplicité. La complexité est un mot problème et non un mot solution. » [3]. Cependant, il reste que deux idées importantes reviennent dans la pensée complexe, celle de l’englobement ou du retour vers soi-même et celle du tissage et de l’ouverture. Englober signifie la possibilité que possède toute chose de se retrouver contenue, comprise, insérée dans un ensemble ou une logique plus vaste, comme pour maintenir ou perpétrer la vie. Cela signifie aussi le fait de se retrouver constamment à l’origine ou comme le point intermédiaire dans une dynamique plus étendue. Edgar Morin évoque par exemple la notion de cycle, soulignant le fait d’alimenter et dans le même temps, le fait d’être alimenté[4]. Réciproquement, tisser implique que les diverses sciences, que les diverses forces, que les sphères qui s’opposent, soient tout de même unies, tissant des liens et ainsi donc, forment une chaîne. Ainsi, englober et tisser est selon Morin, penser le cycle, en ce qu’il s’accorde avec la chaîne, ce qui lui permet d’insister sur la boucle, dans le contexte d’une pensée écologique[5].
Ce système mis en place, où apparaissent contradiction et complémentarité, « invariance et horlogerie »[6], constitue donc une organisation, notion première de la complexité telle que Morin la met longuement en avant dans le premier volume de la Méthode[7]. Plus précisément, il s’agira d’envisager une éco-organisation, afin d’insister sur la dimension écologique de cette organisation, là où une écologie suppose l’interaction de ses éléments, la mise en jeu des conjugaisons et des contraintes, qui finalement, forment un système. C’est aussi ce qui permet de dire qu’une pensée complexe est une pensée de la Physis dans l’idée de décrire la force mystérieuse et croissante qui anime le vivre, qui laisse se déployer la nature.
Dès lors, en vue de mettre en évidence cette force à l’œuvre, Edgar Morin n’a de cesse que de déployer les contradictions et les complémentarités de l’éco-organisation. Il faut cependant se garder de penser cette « contradiction productive » chez Morin, dans l’esprit de la dialectique hégélienne où, rappelons-le, les contradictions se dépassent dans une synthèse. Edgar Morin refuse l’idée de synthèse, en ce qu’elle semble constituer une troisième « solution », autonome et déterministe. Il préfère le terme de dialogique, privilégiant la complémentarité malgré, ou en vertu de l’antagonisme.
Précisons que ce principe dialogique, en ce qu’il entreprend de dépasser la dialectique hégélienne, suppose aussi le dépassement du « troisième terme », puisqu’il s’agit davantage de proposer une multitude de solutions possibles. La dialogique est la recherche du compromis – avec toute la flexibilité que suppose cette notion – bien plus que la recherche d’une solution définitive. Ainsi, penser la complexité dans son rapport dialogique nécessite aussi que soit mise en œuvre une logique de l’immensité des possibles, de la complexification. La complexité est donc explosive, tourbillonnaire, et promise à un bouillonnement de vie[8] ; c’est précisément cette part d’incertitude et d’intensité profusionnelle qui conduit au principe vital, insistant dans l’esprit du compromis, sur l’aspect créateur et adaptatif : le compromis est une autre voie, mais pas nécessairement ce qu’on pourrait nommer une « solution ». Il suppose que l’on crée quelque chose de nouveau, et dans le même temps, que l’on s’adapte.
En effet, l’éco-organisation, en tant que pensée de la Physis, suppose la création, la naissance, l’évolution, la transformation. La vie est l’exact opposé de tout immobilisme ou fixité, elle suppose au contraire le mouvement inventif, l’émergence du nouveau, en contradiction et en complémentarité avec ce qui pourtant la stabilise. L’organisation cyclique, ou réorganisation, laisse croire à une éco-organisation créatrice et productive, comme Morin l’énonce : « la qualité éco-réorganisatrice la plus remarquable n’est pas d’entretenir sans cesse dans des conditions égales, à travers naissances et morts, l’état stationnaire du climax ; c’est d’être capable de produire ou d’inventer de nouvelles réorganisations à partir de transformations irréversibles survenant dans le biotope ou la biocénose. Ainsi nous apparaît la vertu suprême de l’éco-organisation : ce n’est pas la stabilité, c’est l’aptitude à construire des stabilités nouvelles ; ce n’est pas le retour à l’équilibre, c’est l’aptitude de la réorganisation à se réorganiser elle-même de façon nouvelle sous l’effet de nouvelles désorganisations. Autrement dit, l’éco-organisation est capable d’évoluer sous l’irruption perturbatrice du nouveau, et cette aptitude évolutive est ce qui permet à la vie, non seulement de survivre, mais de se développer, ou plutôt de se développer pour survivre. »[9]
Enfin, Morin insistera sur la nature adaptative de l’éco-organisation, notamment au travers d’une écologie de l’action. Or ici, en effet, s’adapter ne signifie pas composer en fonction de ce qui est déjà, mais bien davantage faire en fonction de ce qui risque de survenir. Autrement dit, l’adaptation en son sens complexe, suppose la capacité de s’adapter, ce qui signifie encore la capacité de l’adaptation de soi tout comme la capacité de l’adaptation à soi. Approche qui permet d’insister sur un aspect important, le caractère imprévisible et aléatoire de toute attitude adaptative propre au vivant : s’adapter signifie l’aptitude à s’adapter aux aléas et aux changements[10], d’où également la dimension praxique et stratégique de l’adaptation, notion qui elle-même est vouée à se transformer en fonction des aléas[11].
La pensée complexe de la vie se déploie donc en un mouvement double, un mouvement contradictoire et complémentaire. Il s’agirait d’un côté d’envisager la nature en ce qu’elle a de positive, créative, et sans doute « maternelle, harmonieuse »[12], face à une nature qui serait impitoyable, sélective, éliminatrice. Ces deux conceptions – renvoyant successivement à Rousseau et à Darwin – sont rendues compatibles en un même système selon le principe d’éco-organisation, constituant alors ce qu’on pourrait nommer, la dialogique de la nature. L’éco-organisation est par la suite généralisée pour s’étendre à tout système vivant, communicatif, associatif, évolutif, et diversifié. Il s’agit donc de s’accorder aussi bien à propos des sociétés, qu’à propos des idées, qui aussi se développent et se régénèrent, formant ainsi un système tout autant éco-organisé. Cette capacité qu’a le principe d’éco-organisation à se retrouver dans des domaines a priori externes, résulte de l’application de ce que Morin nomme un regard écologique, consistant à « percevoir tout phénomène autonome (auto-organisateur, auto-producteur, auto-déterminé, etc.) dans sa relation avec son environnement »[13].
Une écologie des œuvres d’art
Dès lors, de quelle façon un regard écologique peut-il être porté sur l’art ? Notre recherche ici se précise. Comment en effet articuler un principe d’éco-organisation, à la question esthétique ? Si le regard écologique signifie l’adaptation d’une logique écologique à tout système, sans doute peut-on explorer une première voie esthétique, en ce que les œuvres d’art forment elles-mêmes un système autonome et en relation avec un « environnement ». En cela, et au même titre qu’il semble possible d’envisager une écologie des idées comme le fait Edgar Morin[14], nous pouvons assurément envisager une écologie des œuvres d’art, pourvu que ces dernières soient comprises à la fois dans une relative autonomie, dans leur fermeture, tout en étant reliées les unes aux autres, c’est-à-dire dans leur ouverture. Or jusqu’où peut-on ainsi dire que les œuvres d’art jouissent de certaines propriétés du phénomène de la vie ?
Ainsi, à propos des idées, Morin écrit : « les idéologies, mythes, dieux cessent d’apparaître comme des ‘produits’ fabriqués par l’esprit humain et la culture. Ils deviennent des entités nourries de vie par l’esprit humain et la culture, qui constituent ainsi leur éco-système coorganisateur et coproducteur. »[15] Ici, il s’agirait donc de comprendre, à partir de l’écologie des idées que formule Morin, de quelle façon une œuvre d’art prend vie. Pour cela, Morin précise que prise isolément, l’idée (l’œuvre d’art) est apparemment dépourvue de vie. Il lui faut davantage se déployer en fonction de la chaîne dans laquelle elle s’insère : c’est le contexte, la situation et le milieu qui lui donne une certaine « organicité »[16]. En conséquence, donc, s’il y a lieu d’envisager une écologie des œuvres d’art, c’est dans la mesure où les œuvres forment un système et se renvoient les unes aux autres, formant une entité organisationnelle « vivante »[17], en cela qu’elles suscitent contradiction, autonomie, complémentarité, échappant tantôt à celui qui les conçoit, prospérant dans les êtres et les esprits, se nourrissant d’eux tout comme elles s’en nourrissent. Les œuvres d’art ont quelque chose de vivant puisqu’elles s’inscrivent dans un mouvement plus vaste d’interactions et de rétroactions constituant tout écosystème[18]. Chaque œuvre d’art semble se lire dans sa dépendance à l’ensemble des autres œuvres d’art, dans un rapport de solidarité.
Cependant, en elle-même, à l’échelle de l’œuvre et non plus dans son rapport aux autres, l’œuvre peut aussi être considérée selon une logique du vivant en ce qu’elle s’inscrit dans le principe de l’autos. Ainsi, parfois, les idées naissent, vivent et meurent, probablement tout comme les œuvres d’art. Bien que les œuvres ne soient pas des idées, (à prendre au sens large nous précise Morin, comme ce qui réunit théorie, philosophie, idéologie), il faut croire que leur création, et leur mise au contact du monde qui les entoure, exerce sur les idées (ou les œuvres), la pression d’une présence extérieure, celle d’un monde environnant entraînant la nécessité de s’adapter et de s’organiser en conséquence. Surtout, les œuvres ou les idées prises une à une jouissent d’une force interne, d’une pulsion de vie qui les porte et les transporte vers une relative consistance, une relative autonomie lui donnant sa qualité, son éloquence, sa force. L’autos signifie que tout être vivant est invité à prendre conscience de lui-même, il se clôt, tandis que l’oikos suppose que tout être vivant soit inséré dans un ensemble plus vaste avec lequel il interagit et où il s’adapte. Puisque tout être vivant est à la fois autos et oikos, il est donc auto-éco-organisé : c’est-à-dire qu’il est tourné à la fois vers lui-même, et vers le monde qui l’entoure. C’est cette particularité finale, la contradiction et la complémentarité qu’admettent l’autos et l’oikos, particularité propre à tout être vivant qu’il nous faut interroger.
La pensée complexe permet de penser le lien entre l’organisation et la désorganisation, entre l’ordre et le désordre, ce qui nous aide à comprendre la vie à la fois comme un affaissement, une décrépitude, là où elle envisage l’émergence de toute chose, en accord avec l’esprit du devenir.
Vie et mort de la vie
La vie se pense de façon duale, dans ses ambiguïtés, rappelant déjà ce que nous disait Héraclite : « vivre de mort, mourir de vie » ; on garde également à l’esprit la célèbre phrase de Xavier Bichat, disant que « la vie est l’ensemble des fonctions s’opposant à la mort »[19], pour conserver cette idée selon laquelle, penser la vie est aussi comprendre ce qu’elle n’est absolument pas. Il faut concevoir le principe « décadent », selon le terme de Schrödinger[20], comme un aspect intégralement constitutif du principe de la vie, nécessitant que l’on saisisse la dualité avec la mort, non comme la distinction de deux forces hermétiques l’une à l’autre. Il faut croire bien au contraire que la mort constitue tout autant l’une des dynamiques essentielles à la vie. C’est aussi ce qu’implique la complexité, comme nous le rappelle Edgar Morin : « nos organismes ne vivent que par leur travail incessant au cours duquel se dégradent les molécules de nos cellules. […] En quelque sorte, vivre, c’est sans cesse mourir et se rajeunir. »[21].
Or, c’est précisément en tenant compte de cette tension entre ce qui devient obsolète, et ce qui émerge comme nouveau paradigme, que nous pouvons renvoyer de façon écologique, aux principes de la vie. Ainsi sans doute est-ce à l’aune de cette contraction avec la « non-vie » qu’il faut appréhender le régime écologique des œuvres d’art. D’où également la nécessité d’envisager, la figure de l’hybride, du transverse, tout comme celle du monstre, en ce qu’il « manifeste en effet, la précarité de la vie et l’inquiète du dedans », selon les mots de Marion Zilio [22], ce qui ne manque pas de nous rappeler en définitive, combien l’idée de la dégénérescence occupe une place entière dans les arts, comme nous l’enseignait par ailleurs les travaux du Land Art, animés de forces entropiques.
Le travail de la décomposition est concomitant avec le travail du développement dans l’ordre du biologique, et cet aspect est clairement exemplifié dans l’œuvre de Michel Blazy, figurant le vivant en laissant s’accomplir les forces naturelles, comme lorsqu’il peuple des espaces de véritables vivariums, ou qu’il dispose certaines matières organiques en vue d’assister à leur décomposition (fruits, biscuits, pâtes, légumes…). Michel Blazy semble exceller dans la mise en place d’un art du vivant, puisqu’il en intègre les principes les plus fondamentaux. Comme le relève Christine Macel, « C’est la fluence dans ses deux mouvements contradictoires et la possibilité d’une concrescence, qui intéressent Blazy. […] Blazy s’attache au processus de l’altération, au changement d’état, au passage d’un état à un autre. Blazy cultive à la fois la génération et la corruption qui ne sont que des cas particuliers de l’altération »[23].
Une œuvre comme celle des Choco-poules, présentée à la Maréchalerie de Versailles, consiste en une installation dans laquelle on peut y voir sur un canapé et une télévision dissimulés sous un drap blanc, trois poules en chocolat. Tandis que le grand drapé figure l’absence comme nous le rappelle l’artiste – puisque c’est ce que l’on fait lorsque les gens sont morts ou absents[24]–, ces poules en chocolat s’avèrent au contraire animées de vie car elles sont saisies dans l’action de picorer. Elles ont cependant l’apparence de poules calcinées, cuites, comme des « canards laqués »[25] , et se retrouvent ainsi saisies dans une étrange dualité : là où le chocolat suppose le plaisir, les poules restent des animaux domestiquées à grande échelle pour des fins alimentaires. Outre le rapport essentiellement dialogique de ce que met en œuvre Blazy, on retient ici l’importance de figurer par l’ambivalence et le jeu des contraires, un certain rapport à la résistance, comme il aime à le rappeler. Toutefois, des œuvres s’attachant à investir les processus contradictoires de la vie ne sont pas forcément celles qui investissent le champ de l’organique. Que l’on songe notamment à ce que permettent des pratiques qui s’emploient à mettre en œuvre des principes liés à la cybernétique, à la vie artificielle, mais surtout à la synthèse de l’intelligence artificielle, dans sa nécessité d’élaborer une pensée auto-éco-organisationnelle. La nécessité d’envisager le traitement de l’information de façon dialogique impose enfin un lien à l’égard de la communication, telle que développée par l’école de Palo Alto ; ce qui en outre évoque les travaux de l’Art sociologique, ou Esthétique de la communication, renvoyant en cela à un art se préoccupant d’une certaine forme d’intelligence collective, mais surtout à l’idée d’immersion et de participation. Dans l’optique d’inclure le tout et les parties, d’assimiler l’objet au sujet, la complexité permet précisément de penser des pratiques contemporaines ouvrant l’art à d’autres perspectives.
Esthétique et non-art
Cependant, peut-on imaginer des œuvres qui dans leur rapport écologique, seraient à la fois tournées vers elles-mêmes, tout en étant ouvertes vers l’extérieur ? Est-il possible de comprendre les œuvres d’art, en ce qu’elles sont fermées et ouvertes ? Oui, dans la mesure où l’œuvre semble faire écho à un double désir. Celui en premier lieu visant à l’édifier en tant qu’œuvre, se saisissant des principes d’individualité, de singularité et d’originalité – principes qu’il faut par ailleurs interroger au regard des idéologies modernistes – et, en second lieu, celui visant à l’insérer de façon cohérente au regard des autres œuvres existantes, dans le présent inévitablement, dans le passé évidemment, et dans le futur probablement.
Dès lors, l’œuvre d’art est à la fois ouverture et fermeture, dans la mesure où elle n’est œuvre qu’en s’ouvrant à d’autres œuvres, alors qu’elle n’est œuvre qu’en se considérant différente des autres œuvres. Aspirant à la fois à l’identité et à une intégration que l’on pourrait qualifier de sociale, l’œuvre d’art entre tout à fait dans le dispositif d’auto-éco-organisation le rapportant au monde des êtres vivants.
Or l’œuvre saisie d’un double désir est aussi une œuvre ancrée dans une double temporalité, dans son oscillation entre ce qu’elle est (déjà), et ce qu’elle n’est pas (encore). Hésitant entre l’être, le « il y a » de l’ouverture et le non-être, le « il n’y a pas » de la fermeture, on notera comme le fait Christine Buci-Glucksmann que cette hésitation, cette articulation correspond au temps intermédiaire du passage et de l’entre-deux, au temps de l’éphémère[26]. Or la vie serait ce qui jouirait de cette double temporalité que signifie le passage et le devenir liés à la Physis, ce qui nous indique également que l’esthétique, que toute esthétique se doit de prendre en compte cette temporalité « vitaliste » articulant ouverture et fermeture. Toute esthétique serait en définitive marquée par le sceau du vitalisme, si on entend par vitalisme l’expression duelle de la contradiction et de la complémentarité telle que Morin l’énonce, faisant de l’esthétique l’horizon même dans lequel s’épanche la pensée complexe. Jacques Rancière écrit par exemple que « La politique de l’art dans le régime esthétique de l’art, ou plutôt sa métapolitique, est déterminée par ce paradoxe fondateur : dans ce régime, l’art est de l’art pour autant qu’il est aussi du non-art, autre chose que de l’art » [27]. L’art dans le non-art n’empêche alors pas la comparaison avec la vie proliférante qui simultanément est vouée à décrépir pour perdurer. Ceci d’autant plus que le rapport que l’art éprouve à l’égard du non-art est lui aussi un rapport créatif et adaptatif.
Une telle esthétique permet de penser son cadre « épistémologique » à l’aune de ses contradictions créatrices, non tant dans la circonscription disciplinaire à laquelle est cantonnée toute « méthode » scientifique, mais dans la possibilité qu’elle a de continuellement laisser germer quelque chose de nouveau, lorsqu’en définitive, cela peut supposer également l’obsolescence d’anciennes pratiques comme on le voit dans l’histoire de l’art. Tout comme pour la vie, la possibilité du nouveau émerge d’une praxis écologique, d’une sorte de jeu entre chacune de ses composantes, là où le jeu suppose l’articulation, la computation, la dialogique entre l’être et le non-être, entre l’art et le non-art.
Conclusion et ouverture : du nouveau
Nourri de deux élans, l’esthétique « praxique », vitaliste, et en définitive, complexe, emprunte les mécanismes les plus essentiels de la vie, à savoir la contradiction et la complémentarité, dans une logique de l’incertain et en prise sur l’action. Là où le jeu de la contradiction complémentaire demeure fondamentalement créateur et adaptatif, laissant sans doute augurer une question beaucoup plus fondamentale, en s’adressant davantage à la raison d’être et à la façon avec laquelle les œuvres d’art s’inscrivent dans le monde. En effet, la création et l’adaptabilité met en exergue la considération d’une certaine temporalité du surgissement de l’être vivant, et donc de l’œuvre, en tant qu’elle est le fruit d’un acte d’invention, novateur, tandis qu’elle s’insère dans un dispositif disposé à l’accueillir, et donc n’est pas si nouvelle que cela. En fin de compte, on se rendra compte que la notion de nouveau est le pont entre une approche culturelle de l’art, et une approche « vitale », au sens ici déployé.
Ainsi, rapporté au monde des arts, la pensée complexe semble interroger l’ambivalence entre tradition et nouveauté, ou plus précisément les conditions de la production du nouveau. Comprenant cette notion dans le cas des œuvres d’art comme une question éminemment culturelle, il est intéressant d’interroger les modalités de sa genèse à l’aune de ce que permet la pensée complexe. En exemple, la question des avant-gardes qui évoque la nécessité de s’émanciper à l’égard d’une certaine tradition, tout en étant dans le même temps repris pour forger une « nouvelle tradition ». Ce qui de surcroît ne manque pas de rappeler l’assimilation du non-art par l’art évoqué avec Rancière.
Une esthétique vitaliste pourrait avoir pour interrogation essentielle la genèse du nouveau. Si ce dernier semble être un fait culturel par excellence – en particulier à propos du modernisme artistique –, il s’agit pourtant de la « vertu suprême de l’éco-organisation »[28] comme nous le rappelle Edgar Morin. Conception qui nous renvoie d’emblée du côté des mécanismes de la vie, comme si vie et culture nouaient une réciprocité aussi inéluctable que créatrice. On perçoit alors qu’approchant la notion de vie, les perspectives à l’égard de l’esthétique restent sans cesse nombreuses et ouvertes, mettant d’une part un terme aux conceptions selon lesquelles il y aurait une « fin », et d’autre part, rendant d’autant plus nécessaire une interrogation à propos de la contemporanéité de cette esthétique, en cela même qu’elle semble toujours nouvelle.
[1] Edgar Morin, La Méthode 2. La vie de la vie, Paris, Le Seuil, 1980.
[2] Jean Tellez, La pensée tourbillonnaire, Paris, Germina, 2009, p. 82.
[3] Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Le Seuil, 2005, « Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. […] La complexité ne saurait être quelque chose qui se définirait de façon simple et prendrait la place de la simplicité. La complexité est un mot problème et non un mot solution. », p. 10.
[4] Edgar Morin, La Méthode 2, op. cit., p.28.
[5] Ibid., p. 29.
[6] Ibid., p. 19.
[7] Edgar Morin, La Méthode 1. La nature de la nature. Paris, Le Seuil, 1977.
[8] Jean Tellez, op. cit., p. 116.
[9] Edgar Morin, La Méthode 2, op. cit., p.35.
[10] Ibid., p. 48.
[11] Ibid., p. 49.
[12] Ibid., p. 57.
[13] Ibid., p.78.
[14] Ibid., p. 84, Voir également La Méthode 4. Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Le Seuil, 1995.
[15] Ibid.
[16] Ibid., « Nous savons qu’un mot dans le dictionnaire est multivalent, qu’il a potentiellement plusieurs sens très divers, et qu’il ne prend son sens que dans le texte du discours qui l’enchaîne et qu’il enchaîne. […] Ainsi le contexte est en fait l’écotexte coorganiteur de tout mot, toute idée. »
[17] Ibid., p. 85.
[18] Jean Tellez, op. cit., p.111.
[19] Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et sur la mort, Paris, Flammarion, 1994.
[20] Ervin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie?, op. cit., p. 170.
[21] Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, op. cit., p. 85.
[22] Voir dans cet ouvrage le texte de Marion Zilio « Vie et contingence, l’effort d’une attitude ambivalente ».
[23]Christine Macel, Le temps pris. Le temps de l’œuvre et le temps à l’œuvre, Paris, Monografik Editions, Editions du Centre Pompidou, 2008, p. 87.
[24] Michel Blazy, « Un observateur du vivant », propos recueillis par Boris Daireaux, www.evene.fr, 2006.
[25] Ibid.
[26] Christine Buci-Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, Paris, Galilée, p. 12.
[27] Ibid., p. 53.
[28] Edgar Morin, La Méthode 2, op. cit., p. 35.

Lorsque l’on essaie de comprendre le monde contemporain, d’envisager la manière avec laquelle il se constitue, il faut admettre que le rôle des images a passé un cap au travers de la logique des réseaux, et plus particulièrement, de la logique participative et interactive de ces mêmes réseaux. Il est vrai que notre civilisation est désormais qualifiée d’iconique, en particulier avec ce que permet le Web. Mais le Web évolue aussi, et laisse surgir de nouvelles pratiques, autonomes, non-gouvernées, participatives, interactives, et sociales. Ce que l’on décrit par Web 2.0. C’est dans cette optique que l’image rumorale est intéressante à aborder, en ce qu’elle semble incarner précisément le type d’image se moulant avec le plus de conformité, à ce que permet notre époque actuelle, à l’aune du Web 2.0. Ainsi, la question que nous voudrions poser est la suivante : que peuvent des images qui sont supposées entretenir une relation de proximité à l’égard de notre époque technique ? Et que serait le rapport au monde de l’art ? Nous procéderons en trois étapes. Il convient dans un premier temps de décrire ce qu’on peut entendre par le terme d’image rumorale.
Qu’est-ce qu’une image rumorale ?
Procédant de touche en touche, se propageant sans rencontrer de réels obstacles, il semble que ce que l’on décrit par « rumeur » soit non seulement exacerbé par le régime technique contemporain, en ce qu’il insiste sur les mécanismes de communication et d’interaction, tout comme la rumeur a toujours été un principe constitutif d’une certaine intelligibilité du monde. En cela la rumeur est propice à un rapport à l’égard du vrai et du faux, à l’égard de ce que nous croyons, de ce que nous savons, et en définitive, de ce que nous pourrions nommer la « réalité ».
Or en règle générale, on a coutume d’associer le principe de la rumeur à des idées ou à des « objets flottants », qui transitent, qu’ils soient avérés ou factices. Ce que traduit également l’association que l’on fait pour parler de la rumeur, avec le « bruit qui cours ». Il semble intéressant de s’arrêter sur les mécanismes de la rumeur, dès lors que l’on passe non plus seulement à une sorte de transmission d’idées flottantes, mais aussi et surtout au régime de diffusion des images tel que notre époque le laisse supposer. Insister sur ce que nous pouvons désormais appeler des « images rumorales », nous permet en outre d’interroger la correspondance possible à l’égard du monde de l’esthétique, et plus particulièrement, de sa proximité avec celui des arts. Ainsi, qu’apportent de plus les images au principe de la rumeur ? Considérons cette image, sans doute fort connue, à tel point qu’elle en devient le motif paradigmatique des analyses sur l’image rumorale.
Il semble a priori qu’il s’agisse d’une photographie touristique, on y discerne la date du 11 septembre. Ainsi un avion s’apprête à percuter la tour ; ce qui est assez remarquable est que la photographie telle qu’on la voit, résulterait des restes issus des ruines du bâtiment détruit. Comme le relève Pascal Froissart[1], ce cliché fut l’objet de discussions ardentes sur le net. On invoque alors différents critères afin de la décrédibiliser (la tenue vestimentaire qui ne correspondrait pas à ce moment de l’année, l’orientation de la tour qui posséderait un observatoire et il ne peut s’agir de cette face-ci, etc.). Finalement, un hongrois dénommé Peter y est démasqué, et ce dernier concède volontiers avoir procédé à un montage numérique sur la base de photographies privées, mais néanmoins antérieures à la destruction des tours. Regardons cette autre photographie dans laquelle Barack Obama semble parler dans un combiné téléphonique à l’envers.
Diffusée en mars 2008 sur le net, cette image ne manqua pas de provoquer diverses railleries, puisqu’Obama est encore à cette époque au coude à coude avec Hillary Clinton pour remporter les primaires. Les commentaires des internautes font montre d’une certaine ironie, se demandant si réellement cet homme veut devenir le président des Etats-Unis. On imagine assez aisément les conséquences qu’une telle image serait susceptible de véhiculer auprès d’un public d’internautes, en pleine campagne électorale. Ce qui est en revanche assez surprenant, est de pouvoir consulter quasiment simultanément cette autre photographie, rétablissant quelque peu l’ordre des choses. En comparant ces images, on constate également l’apparition mystérieuse de l’horloge murale. L’explication résulte de la « fictionnalisation » dont fut sujette l’image factice, apparue originellement sur un blog politique de vocation plus ou moins humoristique. L’image avait alors pour commentaire : « une crise internationale émerge à 3h du matin, Barack Obama répond au téléphone »[2], faisant écho a ce qu’Hillary Clinton pu dire dans sa campagne, enjoignant les votants à choisir qui répondra au téléphone. Considérons ce dernier exemple.
Ici, des photographies prises à l’intérieur d’un avion en train de s’écraser, et correspondant à un vol brésilien dont l’accident aurait réellement eu lieu. La personne ayant amorcé ces images impressionnantes donne tout un ensemble d’indications en guise de légende. On apprend ainsi les caractéristiques et références précises du vol et de l’appareil photo, tandis que la carte mémoire de l’un des passagers est semble-t-il restée intacte. Ce qui est surprenant dans ces images, c’est qu’elles ont subitement ressurgies sur le net, lorsque l’année dernière eu lieu l’accident d’Air France au milieu de l’Atlantique. En réalité, il s’est avéré que ces images provenaient de la série télévisée Lost, un regard plus attentif peut rendre compte par exemple des menottes attachées à la jeune femme au premier plan. On notera enfin que l’image rumorale ne signifie pas forcément une image photographique retouchée et qu’elle ne se diffuse pas uniquement sur les réseaux électroniques ; il peut tout autant s’agir d’un diagramme, ou d’un dessin humoristique, tout comme elle peut être diffusée par voie de presse (songeant par exemple aux avis de recherche qui relève de ce dispositif). Ajoutons à cela que le principe de l’image rumorale, renvoie dans une certaine mesure à la vidéo rumorale, en ce que les possibilités d’échanges de fichiers atteignent désormais une vitesse suffisamment propice pour des fichiers de plus en plus lourds.
Une typologie de l’image rumorale
Mais que dire de ces images ? Partageant avec les rumeurs la plupart des tenants, ces images rumorales ont la particularité d’être particulièrement rétives lorsqu’il s’agit d’en forger une typologie. A l’instar de la rumeur, on concèdera volontiers qu’il existe toutes sortes d’approches et de définitions, et surtout, sa compréhension semble être partagée par le plus grand nombre alors que très peu sont capables de dire de façon concrète ce dont il ressort[3]. Il semble pourtant possible de relever quelques critères qui nous permettront d’aller plus loin.
– Absence de motivations claires
Constatons préalablement qu’il est difficile – et parfois impossible – de déterminer les auteurs de telles images, tout comme les motivations qui les animent sont tout à fait hétérogènes. Pour la première image, l’auteur Peter explique avoir voulu faire une plaisanterie à l’adresse de ses amis, là où la seconde image peut sans doute se prévaloir d’une lecture quelque satirique, voire subversive, si ce n’est directement impliquée politiquement, encore que cela se fasse sur un mode plutôt humoristique. Quant à la dernière image, son auteur Carlos Cardoso explique vouloir montrer aux gens à quel point on n’est jamais trop sceptiques face aux images, à juste titre, sur Internet[4].
– Narrativité exacerbée
Si les motifs divergent, ces images ont en revanche pour point commun d’être particulièrement parlantes. C’est là le point essentiel sur lequel Pascal Froissart entend insister, parlant alors d’une « narrativité exacerbée »[5]. La caractéristique essentielle de ces images ne relève donc pas tant des motivations de chacun, ni même de leur rapport à une certaine véridicité dans le propos, mais davantage de leur capacité à se tenir d’elle-même, de façon extrêmement explicite et volubile. Ces images sont en quelques sortes « parlantes », en ce qu’elles infèrent quasiment dans l’immédiateté de leur vision, de leur réception, un sens très concis, mais surtout, qui remet en question une certaine habitude dans l’ordre du Voir. En effet, jouant avec l’humour, le catastrophisme, ou l’étonnant, ces images relèvent toutes, dans une certaine mesure, de l’extraordinaire. Des images rumorales ne peuvent se contenter d’être des images renvoyant à une certaine monotonie quotidienne, elles sont toujours ce qui fait réagir, et c’est sans doute là que réside l’aspect rumoral : puisqu’elles font réagir, elles poussent celui qui les perçoit à la montrer à d’autres. C’est parce que l’image détonne, qu’elle est invitée à se propager. Bien plus, c’est parce que sa narrativité est exacerbée que l’on peut penser qu’elles visent à accaparer l’attention du récepteur en un minimum de temps.
– Interroge la réalité
Ajoutons que dans cette idée d’image extraordinaire, l’image rumorale interroge un certain rapport à la réalité. Puisqu’elle magnifie la perception du monde, puisqu’elle donne ce qu’on a peu l’habitude de voir, elle tend aussi à induire en erreur, ou du moins, elle interroge sur la réalité de ce qui est perçu. L’extraordinaire signifie aussi être dans un au-delà de la réalité. Le vraisemblable passe pour une duperie là où une duperie passe pour une vraie chose, et nous entrons au cœur de la notion de rumeur, là où bien souvent elle implique une déformation de la réalité, un bruit qui court.
– Se propage par l’action de celui qui la perçoit
Faisant l’économie d’un certain temps de lecture et jouant avec l’immédiateté de leur réception, ces images ne manquent pas de tracer le parallèle avec des images publicitaires, à la différence près que désormais, le récepteur devient celui qui, en quelque sorte, porte le message publicitaire en le relayant. Autrement dit, outre le fait que l’image en dit beaucoup malgré toute son immédiateté, le principal moteur lui permettant d’être rumorale, repose sur le récepteur. C’est celui qui la regarde, qui est invité à la diffuser. Cette capacité qu’a l’image rumorale à provoquer l’envie d’être partagée est naturellement bien perçue par les publicitaires, bien qu’en l’occurrence il s’agisse davantage de vidéo ou d’effets d’annonce. L’image rumorale cependant semble profiter de la même efficacité sémantique, interrogeant par ailleurs sa mise à l’écart à l’égard du monde de l’art, dès lors que ce type d’image soulève bien souvent des critiques à l’encontre d’une approche jugée commerciale et consumériste.
– Il n’y a généralement pas d’auteurs
Ce qui ne manque pas de souligner que l’auteur de l’image rumorale est généralement difficile à déterminer. L’image rumorale est une image dont on ne connaît ni le début, ni la fin, et en cela, on peut dire que c’est une image qui se saisit généralement « par le milieu », puisque celui qui la perçoit n’en est que le vecteur de diffusion. On peut penser que c’est précisément cette absence d’identification qui confère à l’image rumorale une importance que l’on qualifiera de sociologique, en ce qu’elle symbolise une image qui serait portée par une sorte d’imaginaire collectif. L’image rumorale relève de l’anonymat, mais plus que cela, il s’agit d’un anonymat au même titre que l’on songe à un « collectif ». C’est aussi un aspect dont il faut tenir compte lorsque l’on considère des images publicitaires. En effet, dans ces dernières, bien que l’on n’identifie pas l’auteur précis de ces images (le graphiste, le directeur artistique), en revanche elles supposent toujours – et c’est sa fonction – que l’on puisse y reconnaître l’organisme ou la compagnie qui la diffuse. Ainsi donc, si l’image rumorale partage avec l’image publicitaire son efficacité sémantique, l’absence d’identification (et de motivation claire), fait d’elle ce que nous pourrions nommer une image « sociologique », dans l’idée qu’elle appartient davantage, semble-t-il, à une culture, ou à un collectif donné.
Dans le paysage quotidien, on trouve différents types d’image qui semblent parfois proches de l’image rumorale, mais qui n’en relève pourtant pas. Il reste important de bien saisir ce qui les distingue, car c’est précisément à partir de là que l’on se rend compte que la particularité de l’image rumorale est une certaine relation avec le contemporain.
– Les images véhiculées par les réseaux sociaux, tels que Facebook ou MySpace ne sont pas des images rumorales, bien qu’elles transitent par les réseaux électroniques. En tout cas lorsque l’on considère des photographies de « personnes », les motivations sont plus ou moins prononcées. Mais surtout, ce type d’image permet toujours de revenir à la source, et est en définitive peu encline à se propager de façon virale, tant elle semble se cantonner à un cercle limité de relations. La principale différence à l’égard des images rumorales consiste donc en une supposée identification des auteurs (une photographie de « personnes », dans un contexte de l’individualisme postmoderne).
– Les images de presse, d’information, ou publicitaires, telles qu’on les retrouve dans les journaux à tirage papier, ne sont pas non plus des images rumorales. Ici aussi, le principe même de la déontologie journalistique suppose que l’on retrouve toujours ses sources, contrairement à l’image rumorale. Ajoutons à cela que l’image est diffusée de façon canalisée, non pas de façon imprévue, portée par les récepteurs.
La question artistique : une image sociologique
Toutes les images évidemment ne sont pas de l’art. Il reste que celles supposées relever d’un parti pris artistique posent problème lorsque l’on considère leur possibilité de réalisation dans le cadre de la rumeur. En effet, en considérant les images à propos de pratiques artistiques dont la vocation n’est pas explicitement d’être « rumorales », force est de constater qu’elles sont rarement partagées et diffusées de façon virale. Ce n’est pas la photographie du travail de tel artiste qui pousse l’internaute à la transmettre à ses amis. De même, l’art numérique dans lequel des images électroniques sont générées en vue de percevoir une certaine esthétique « digitale », ne relève pas de l’image rumorale, tant il semble que l’image soit le fruit d’une production qui ostensiblement entend se prononcer sur le champ de l’imagerie « esthétique », et dans une certaine mesure, de souligner l’importance créative de son auteur.
Sans minimiser l’impact du réseau et des pratiques de l’échange d’image, ce type d’images est restreint par le public auquel elle s’adresse, puisqu’il semble moins universel que le projet d’un collectif, à l’échelle d’une culture ou d’une communauté. Pour être rumorale, l’image d’art doit s’ouvrir au collectif, et donc être quelque peu « sociologique ». Quand bien même l’image serait « excessivement narrative », l’image d’ « art » semble rester confinée à un réseau de spécialistes, si elle n’incite pas spontanément l’internaute à la diffuser, quitte à perdre la trace de son auteur.
Pourtant, si l’image rumorale relevait de l’art, les enjeux seraient conséquents, eu égard à l’idée que l’on se fait des pratiques surdéterminant le rôle et la place de l’auteur. C’est aussi interroger la frontière entre art et non-art, dans la mesure où d’une part, elle est sujette au travers des réseaux, à être portée au cœur des espaces les plus démocratiques et les plus hétérogènes qui soient, multipliant les publics, les tranches d’âges, et se confrontant d’emblée au regard de celui qui n’entend rien à l’art. Art et non-art car, d’autre part, la « pratique » de l’image excessivement narrative suppose une proximité sémantique à l’égard d’autres images que l’on rencontre dans le champ de la communication par exemple. Dans tous les cas, il s’agirait de confronter l’art tel qu’il est conventionnellement reconnu, à une pratique déplaçant ce que l’art dit moderne a pu ériger par ailleurs. S’opposant de plus à un art « élitiste » au profit d’un art qui pourrait être « populaire » (non pas au sens d’une décrédibilisation en terme de qualité, mais plutôt dans l’idée où chacun se l’approprie), cette image rumorale (impossible) est une image qui s’offre à tous, qui étonne suffisamment pour que celui qui ne connaît rien à l’art soit tout de même invité à la partager. C’est une image qui en quelque sorte reflète les attentes et les aspirations de ses intervenants, elle serait donc une image du collectif, tout comme elle serait une image collective.
Or le collectif n’est pas nécessairement ce qui fait obstacle à l’art, c’est plutôt, encore une fois, cette idée de l’image. En exemple, on peut tracer le lien à l’égard d’autres pratiques comme avec l’Art sociologique, ou Esthétique de la communication énoncée par Fred Forest en 1983, ce qui permettra de nous rendre compte que l’image collective n’a jamais été envisagée dans ces approches. Bien davantage, il semble même qu’elle soit en quelque sorte honnie, dans la mesure où elle suppose que l’on s’attache à des particularités esthétiques. Ce qui s’explique dans l’optique de Forest par l’association (un peu surfaite et caricaturale) de l’image dans sa propension à ne véhiculer que des idéaux de beauté ou d’expériences dites « esthétiques ». N’insistant pas sur la valeur iconographique de l’art « collectif », Forest préfère reporter son appréciation sur ce qui fait l’œuvre, et ce que peut l’œuvre. Ainsi, si l’image rumorale n’est pas de l’art, c’est parce que le « medium est le message » : ce n’est pas l’image qui compte, c’est le geste, le transfert, sa diffusion et les modalités médiatiques qu’elle présuppose. L’aspect collectif d’une telle image ne peut qu’évoquer les usages de l’art sociologique, qui justement, entendait à travers des pratiques participatives, ouvertes à la diversité des publics et des approches, produire des œuvres affranchies de la surdétermination de leurs auteurs. On pourrait aller jusqu’à dire qu’il existe un art rumoral, lorsqu’il s’agit de diffuser, de faire participer un collectif et donc, de faire disparaître l’auteur de l’œuvre qui se déploie quasiment de façon autonome, à la manière d’un organisme ou d’un virus dans le corps social, au travers des réseaux électroniques. Songeons en exemple au principe du « jeu du téléphone »[6], tel que Fred Forest par exemple a pu l’élaguer depuis les années 70. Mais le cas d’une image qui serait investie des mêmes critères semble impossible à réaliser, à moins de modifier la compréhension que l’on se fait de l’art, notamment en le saisissant dans son ouverture. Mais n’est-ce pas également supposer que tout est de l’art, et que n’importe qui peut se réclamer le titre d’artiste ?
Première conclusion. L’image rumorale est une image du contemporain
C’est pourquoi l’image rumorale est un défi posé à la question de l’art. En effet : est-ce encore de l’art si il n’y a pas d’artiste, et si l’image est produite de façon « arbitraire », sans qu’à aucun instant n’intervienne chez l’auteur anonyme, le projet de réaliser une œuvre artistique ? Une image serait-elle encore rumorale, si elle est originellement initiée par un artiste, et proposée dans une optique bien précise ? Dans le meilleur des cas, on peut imaginer qu’un artiste s’attache à créer ce type d’image dont l’objet serait d’être véhiculée d’internaute en internaute, prenant alors le risque d’oublier son auteur, et surtout, prenant le risque d’être prise pour ce qu’elle n’est pas, à savoir, non plus comme une image d’art, mais une image dont on ignore les motivations et qui s’échangent parce qu’elle étonne. On pourrait même pousser le raisonnement un peu plus loin, en nous imaginant qu’il y a peut-être des images que l’on a pu échanger, dont on a pu s’étonner, et puisque l’on ne sait jamais réellement quelles furent les motivations premières de celui qui les a engendré, peut-être des images « artistiques » sont-elles passées sans que jamais nous ne le sachions. L’image rumorale serait alors une image dissolue : qu’elle puisse un jour avoir relevé d’un projet artistique concret, nul ne peut le savoir. A moins de supposer que l’art est partout, que l’art s’aventure désormais sur le terrain du social, de l’anthropologique, et des imaginaires latents, l’image rumorale n’a que peu à voir avec ce qu’on entend traditionnellement par art. Pourtant c’est vers cette tension entre art et non-art que nous voudrions continuer à nous orienter. Et si en effet, la contemporanéité de l’art, son devenir, était justement de bifurquer vers ce non-art ? Comme si l’image rumorale ne pouvait s’accommoder par définition d’un principe artistique. Il faut admettre qu’il est difficile de trouver une image artistique rumorale, car il faudrait songer à une image capable de s’adresser de façon réactive à tous (elle donne envie d’être partagée), sans distinction de public ; ce qui aurait pour conséquence d’introduire l’art du côté du non-art. Ou encore, autre hypothèse, c’est la notion d’image qui est à revoir dans les pratiques artistiques.
L’image rumorale ne signifie-t-elle pas qu’il faille pouvoir penser une autre façon de concevoir ce qu’est une image artistique, notamment en la confrontant à ce qui pourrait être une non-image ? L’hypothèse est donc celle-ci : ce n’est pas tant les images qui nous interrogent, ce n’est pas tant ce qui est visible dans ces images qui infèrent un discours sur le plan artistique. C’est plutôt le rapport au contemporain. C’est du reste ce qu’implique l’idée de Medium is Message, dans la mesure où insister sur une extériorité du message est lui conférer une consistance contextuelle. Il s’agit de comprendre la relation technique que le message entretient avec son époque, et plus particulièrement, dans l’idée que cette époque est précisément celle qui se place sous l’égide d’une exacerbation de la communication et de la logique de l’échange. Le contemporain désigne ici l’époque historique telle qu’il est déterminé par des velléités qui lui appartiennent en propre, à savoir l’aspect culturel, social, économique, idéologique, mais aussi et surtout, technique. Et ce contemporain est le contemporain d’Internet. Une image rumorale se doit d’interroger sa relation avec ce contemporain, et on se rend compte alors qu’aucune autre image n’exerce avec autant d’accordance ce rapport à son époque, tant elle semble en investir tous les codes. L’image rumorale est une image contemporaine car elle incarne tout ce que « peut » le contemporain. Et donc, que peut le contemporain, lorsqu’on l’envisage sous l’angle de la technique et du numérique ? On peut faire émarger quelques aspects qui reviennent assez fréquemment.
– L’esprit du Web 2.0 désigne les réseaux tels qu’il évolue de façon imprévisible, à partir des pratiques sociales, collective, donc, indépendantes et non concertées, donnant toutefois lieu à des « émergences » ou des concrétions. C’est par une logique de l’interaction simultanée que le Web devient « social ». Et c’est aussi cet esprit de la socialité qui autorise l’image rumorale de se répandre. Cela signifie par exemple que l’on tienne compte de l’aspect participatif, de l’ancrage dans les pratiques, dans la praxis. Il s’agit aussi d’insister sur l’interactionnisme, sur le rapport au collectif, sur la nécessité d’en passer par des technologies de la communication. Il est vrai qu’il y a eu de tout temps des images rumorales, mais telles qu’elles sont formulées ici, aujourd’hui, ce qui change est l’aspect électronique et la facilité de leur diffusion.
– Le numérisme, qui signifie la capacité qu’offre la technique contemporaine de démocratiser le feedback et la retouche d’un côté, notamment la retouche textuelle ou la retouche des programmes propres aux images. Le numérisme, ce que « peut » le contemporain technique, autorise également une accointance avec une certaine perfection numérique, dans l’ordre du calcul, au travers de gestes automatisées et guidées par l’ordinateur. Et ceci de façon universelle, facilitée, justement telle que le permet le Web 2.0 (les internautes n’ont pas besoin de connaissances techniques dans le Web 2.0, tout y est déjà conditionné). C’est aussi ce qui permet à de plus en plus d’utilisateurs d’investir le champ des images sans pour autant nécessiter un savoir-faire des plus aboutis. A peu de chose près, l’image rumorale dans ce contexte, peut être l’œuvre de quasiment n’importe quel internaute.
– La conscience de l’immédiateté. Le contemporain dont nombre d’auteurs soulignent l’accélération et la vivacité des mutations, supposent aussi que tout se passe dans le temps du provisoire, de la vitesse et de l’immédiat, qu’il s’agisse de penser en terme de résultat, ou des rapports de flux, ce que peut le contemporain est d’investir ce contexte profusionnel. L’image rumorale a de toute évidence à voir avec l’immédiateté, comme nous l’avons vu avec l’immédiateté de la lecture de l’image, tout comme elle est vouée à s’échanger quasiment au moment même ou l’internaute la perçoit. Ce que ne trahit pas par exemple l’idée d’interconnexion technique, où chaque appareil dispose progressivement d’une connexion à Internet lui permettant d’interagir en temps réel, et de diffuser dans cette immédiateté ces images.
Seconde conclusion. Le contemporain se construit
Ces trois critères non exhaustifs, permettent néanmoins d’envisager de façon sans doute quelque peu caricaturale le rapport de l’image à l’égard de notre époque, il semble ainsi que l’image rumorale est précisément ce qui correspond le mieux à cette contemporanéité. Surtout, comprenons que l’image rumorale n’est pas ce qui se conforme à son époque, elle en est à la fois à l’origine, tout comme elle en est issue. Ce double rapport à l’égard du contemporain, cette circularité entre ce qui est à la fois l’origine et l’achèvement, formule ce qu’on décrit généralement par constructivisme. Ce qui est construit, c’est le contemporain, tout comme le contemporain construit les réalités dans lesquelles les hommes se meuvent. Le constructivisme, point le plus important, est l’idée selon laquelle ces interactions, qui confrontent différentes réalités entre elles, finissent par infléchir le champ de la réalité. Ce sont les hommes qui dans leurs interactions construisent une certaine perception du monde, et les images rumorales sont également des perceptions du monde, bien qu’elles interrogent le rapport à la réalité de ce qui est perçu. C’est ce qui nous permet de formuler l’idée d’une construction de la réalité, par l’image, ce qui soulève pour nous 3 remarques.
– Premièrement, et en règle générale, lorsque l’on aborde un « constructivisme », ce qui se traduit tout autant par interactionnisme, on se place davantage sur le plan sociologique, mais surtout, on considère que le maître mot des mécanismes opérants dans la compréhension d’une société, est celui de sujet, puisque tout se fait du point de vue des individus. Rappelons donc de ce fait, qu’un constructivisme signifie que dans une configuration sociale, les représentations collectives, les imaginaires sociaux, la constitution des idées, ne sont pas érigés de toute pièce par une instance transversale, reculée et prédominante. Il s’agit davantage de considérer que ce qui forge tout ceci, est le fait des individus, saisis dans leurs interactions mutuelles et complexes. Cela signifie aussi que ce ne sont pas nécessairement les individus qui en quelque sorte, « subissent » la société, ou l’ingèrent passivement, mais au contraire, qu’ils en sont à l’origine. Pour le dire autrement, ce sont les hommes qui construisent la réalité du monde, et non l’inverse. Ainsi, concernant l’image rumorale, tout le propos sera d’envisager une lecture esthétique du paradigme constructiviste.
– Deuxièmement, que faut-il entendre par cette notion de réalité ? Nous venons d’évoquer tout ce qui résulte des imaginaires sociaux, des représentations sociales et collectives, mais aussi de la constitution des savoirs, des idées, des théories, des doctrines, ou des idéologies. Or, bien que tout ceci semble évoquer le monde abstrait et diffus des idées, il faut croire qu’au contraire, la réalité est quelque chose de tout à fait matérielle, de tout à fait tangible. Bien que la notion de réalité puisse s’énoncer de façon variée selon les approches, ne nous attardons pas sur des considérations philosophiques, mais considérons avec Peter Berger et Thomas Luckmann, les auteurs de La construction sociale de la réalité, la réalité en ce qu’elle désigne la réalité de la vie quotidienne[7], celle qui « se présente elle-même comme une réalité interprétée par les hommes et possédant pour ces derniers un sens de manière subjective, en tant que monde cohérent »[8].
– C’est ce qui permet d’en venir à notre troisième remarque. En effet, considérant la nature quotidienne et matérielle de la réalité que l’on considère, il devient intéressant de penser le rôle de l’immatériel dans cette construction. Si la réalité est si tangible que cela, comment se fait-il que l’on envisage sa construction à l’aune de tout un ensemble d’éléments aussi impalpables et flottants que des idées, des théories, des idéologies ? De plus, de quelle côté situer les images, d’autant plus que désormais le paradigme constructionniste est désormais imparti à un monde dans lequel règne le virtuel et les échanges désincarnés ? En réalité, il s’agit de ne pas omettre dans le procès de construction de la réalité quotidienne, la dimension interactionniste, au sens où en permanence règne deux composantes, en interaction, d’où la nécessité de penser le rôle du processus de diffusion, d’émission, et de réception dans le corps social.
Terminons par cette formule, « une construction esthétique de la réalité ». Nous avons vu que l’image rumorale éprouvait des difficultés lorsqu’il s’agissait de la considérer dans une perspective artistique. Peut-être que des artistes se sont saisi de cet objet, mais le principe même de l’image rumorale réfute l’identification de l’artiste, ce qui aurait pour conséquence de faire perdre la valeur « art » de l’image rumorale qui, dès cet instant, devient une image comme toutes les autres images, du point de vue iconographique. L’hypothèse qu’il faut donc porter est celle d’une construction esthétique de la réalité quotidienne, contemporaine, au sens où ce qui contribue à formuler une compréhension du monde se fait tout de même par des images. La rumeur jouait déjà ce rôle de construction de la réalité. On peut songer par exemple qu’un groupe d’individus déclare qu’une hausse du prix du pétrole est éminente, pour que le lendemain un bataillon d’automobilistes se rue sur les stations-service, provoquant justement la hausse du prix du pétrole[9]. L’image rumorale aurait cette même capacité, il suffirait que de telles images infléchissent la manière de voir le monde, pour que le monde soit à son tour infléchit. Et si nous devons insister sur ce terme d’esthétique, ce n’est non tant pour indiquer que le monde s’embellit, qu’il devient plaisant à voir, mais qu’il est perçu dans ses idéologies, dans ses compréhensions et ses affects, aussi et surtout par le biais d’images. Ce que l’on retient, c’est l’idée de compréhension et de genèse du monde par la perception. Une construction esthétique de la réalité suppose donc le règne du Voir. Ainsi, la seule alternative pour penser le rapport à l’art à partir de ces images, est d’infléchir le sens de ce que nous pouvons entendre par esthétique. Serait esthétique non pas ce qui est beau, mais ce qui tisse une interaction à l’aune d’une certaine perception. L’ordre contemporain suppose qu’il y ait esthétique, lorsqu’une connexion est établie de façon à laisser agir nos sens, nous poussant à notre tour à agir, ce que permettent des images extrêmement narratives.
[1] Pascal Froissart, Les images rumorales. Une nouvelle imagerie populaire sur Internet, www.lcp.cnrs.fr/pdf/froi-02b.pdf.
[2] http://urbanlegends.about.com/library/bl_obama_phone.htm
[3] Pascal Froissart, La rumeur. Histoire et fantasmes, Paris, Belin, pp. 23-24.
[4] http://urbanlegends.about.com/library/bl_photos_gol_737_crash.htm
[5] Pascal Froissart, Les images rumorales. Une nouvelle imagerie populaire sur Internet, op. cit.
[6] Scientifiquement nommé « Expérience de Stern », cf. Froissart, op. cit., p. 66.
[7] Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Armand Colin, p. 72.
[8] Ibid., p. 70. Nous soulignons.
[9] Exemple de Paul Watzlawick, l’invention de la réalité, Paris, Le Seuil, 1996.
texte de la communication de la journée d’étude « L’image à la puissance image », Rennes, janvier 2010.

Il serait illusoire de penser aborder la question du centre et de la périphérie de façon exhaustive, comme si ce thème constituait en soi un sujet d’étude aux contours déjà délimités. Une approche esthétique serait rendue tout aussi difficile pourvu que l’on ait conscience de la diversité avec laquelle ces notions peuvent se lire. S’agit-il par exemple de comprendre les relations hiérarchiques qui peuvent subsister entre art et « non-art », des rapports entretenus par la diversité des médias dont dispose l’art dans le cadre contemporain, ou encore de l’émergence d’une représentation évoquant le centre et la périphérie ? La multiplication des niveaux de lecture nous oblige à faire un choix plus spécifique. Ayant pour point de départ la constatation selon laquelle les notions de centre et de périphérie impliquent un rapport de force, voire une relation de domination imposée par une instance « supérieure » – une idée de l’ordre et de la hiérarchie en somme – il semble assez évident que ces notions se lisent selon une multitude de pratiques possibles, comme en témoigneraient les domaines de la sociologie, de l’économie, de la géographie, des sciences, de l’urbanisme, de l’architecture, ou de la philosophie. Sans doute cette richesse exprime-t-elle l’actualité et la nécessité de saisir conceptuellement ces notions. Dans cette optique, quelle place donner à l’art si tant est que la question du centre et de la périphérie interpelle un rapport à l’ordre et à la hiérarchie ?
En choisissant d’orienter notre recherche autour de la possibilité d’une représentation des notions de hiérarchie ou d’organisation picturale, nous nous donnons pour projet de montrer que loin d’être un rapprochement circonstanciel, l’art et les notions de centre et de périphérie entretiennent une liaison fort singulière, mais surtout, porteuse de sens dans le contexte contemporain. En effet, si une peinture s’adonne à une représentation plus ou moins littérale du centre et de la périphérie, que peut-on en dire de plus ? Peut-on dépasser le simple cadre de la représentation plastique – c’est-à-dire aller au-delà du fait de reproduire ou d’illustrer – pour porter le problème de la hiérarchie en art, vers des interrogations beaucoup moins conventionnelles ayant trait par exemple à l’ordre, à l’organisation sociale et à la discipline ? En somme, est-ce que peindre le centre et la périphérie serait se porter garant d’une réflexion en résonance avec des motifs sociaux, voire contemporains ?
L’ampleur apparente de ces deux expressions se confirme lorsqu’on envisage la diversité avec laquelle on peut les contextualiser. En procédant de façon très littérale, le centre et la périphérie évoqueraient les rapports de forces que l’art peut mettre en jeu dans son propre milieu. Autrement dit, une approche de l’art d’obédience sociologique, anthropologique, philosophique, et peut-être même politique, serait tout à fait envisageable lorsque l’on interroge différents dualismes récurrents en art. Ainsi, l’art officiel face à l’art privé, l’art des pays occidentalisés face à l’art des pays en voie de développement, l’art contemporain face à l’art de masse. On peut voir à ce propos que tous ces couples s’articulent autour d’une autre conception, celle de la norme. Il y aurait alors un véritable art, correspondant aux critères qu’instaurent les différents acteurs du monde de l’art, comme l’énonce Arthur Danto. Le statut de cet Art bénéficiant de toutes les attentions théoriques et souvent pécuniaires, est d’autant plus paradoxal si on le qualifie en termes de correspondance à une norme, en songeant par exemple que de tous temps, l’art a justement été ce qui progressivement s’affranchissait des normes institutionnelles. C’est ce qu’évoque le principe de l’avant-gardisme par exemple. Il y aurait alors un art reconnu comme tel, et en périphérie de celui-ci un art qu’il faut oublier, un art dont on ne saisit pas très bien le statut, et dont on hésite même à qualifier d’art. Problème de la qualification de ces « artefacts » ou « objets non-fonctionnels », qui n’est sans doute pas nouvelle, il faut se rappeler qu’au Moyen-âge, on ne distinguait toujours pas l’artiste de l’artisan. On peut d’ailleurs ajouter sur un autre plan, que le rôle historique du statut de l’artiste face à sa production plastique, ne se conformait non plus à une sorte de norme, mais faisait plutôt face à une idéologie dictée par le contexte religieux plaçant Dieu au centre de l’univers, et seul susceptible de s’adonner à l’acte créateur. Le repositionnement progressif de l’homme au sein de la configuration cosmologique – eu égard à l’avènement de l’Humanisme par exemple, tel qu’il apparaît à partir de la renaissance – sa reconsidération en tant qu’organe central de l’univers ainsi qu’une remise en question de ses limites intellectuelles, s’accompagne d’une revalorisation des modalités propres à la création plastique. Ce qui se traduit sur le plan des arts par l’émancipation de l’artiste créateur, au profond élargissement de sa subjectivité, ainsi qu’au mythe du génie artistique. A ce stade, la présence d’une notion de hiérarchie se confond quelque peu avec l’accoutumance relative à une sorte de norme, et ne fait qu’aborder l’art dans sa dimension la plus universelle. Ces considérations préliminaires nous montrent que l’art, dans son fonctionnement et par son contexte, a profondément à voir avec une idée de l’ordre et de sa place au monde. On parlerait de hiérarchie dans l’art pour indiquer qu’il existe un art dominant, juste et acceptable comme tel, mais on pourrait également souligner qu’au sein même des différents médias plastiques, comme lorsqu’il est question d’aborder le statut de la littérature, de la poésie, du cinéma, et plus récemment de la photographie, ce statut d’art ne s’est pas toujours acquis de façon spontanée. On remarquera d’ailleurs, que la question de la hiérarchie interroge toujours en fonction d’une volonté de définir ce que précisément est l’art.
Cependant, afin de voir si une « esthétique du centre et de la périphérie » se justifie, il faut désormais envisager des œuvres qui laissent apparent une représentation de ce couple de notion. Plutôt que de nous attarder sur le contexte environnant, sur la notion d’art en général, tentons de discerner au sein même des œuvres ce qui renvoie à une imagerie du centre et de la périphérie, et d’en tirer les conséquences. Peut-on effectivement représenter la hiérarchie ? De façon intuitive, on devine qu’en insistant sur les compositions que nous offrent les images de l’art, une certaine idée de l’organisation spatiale se dessine, et surtout, qu’elle a subi au cours de l’histoire des évolutions notables. Il semble possible de distinguer quelques moment-clés caractéristiques, que nous pouvons chronologiquement regrouper en trois étapes charnières, bien que rien ne dise qu’en approfondissant davantage le sujet, nous ne pourrions y déceler des ramifications subalternes.
Par ce biais, une première étape de « l’histoire de la distribution picturale » serait franchie aux alentours du XVIe siècle avec les peintures de Bruegel et de Bosch, comme le relève la philosophe Christine Buci-Glucksmann[1]. En décrivant des paysages urbains par l’utilisation d’un point de vue reculée, à la manière d’un satellite ou d’un oiseau en plein vol, Bruegel permet à l’image peinte de s’extraire d’un système de représentation où primait jusqu’alors l’œil du peintre saisit comme une « fenêtre sur le réel », selon les termes de Vasari. La distribution des éléments que composent la peinture est alors radicalement modifiée, non plus une histoire, une situation, un événement, mais avant tout un panorama descriptif d’une multitude d’histoires, de situations et d’événements. Le recul de l’œil de l’artiste – et donc de l’œil du spectateur – a pour conséquence de reconfigurer la position de chaque élément, de chaque détail, de façon contingente, et non plus structuré afin de guider le regard du spectateur comme dans une peinture figurative conventionnelle. La surface peuplée de la peinture pourrait donner lieu à des considérations d’ordre sans doute socioculturelle, si tant est que la peinture offre une vision de l’organisation sociale des individus dans un espace donné, à la manière d’un entomologiste, ou comme peut le faire de manière plus contemporaine en employant le médium photographique, Andreas Gursky[2]. Nous nous retiendrons de tirer des conclusions hâtives à propos d’une peinture dont une lecture « sociale » serait difficilement envisageable, puisqu’elle mettrait en jeu des notions n’apparaissant pas encore à l’époque.
Etant face à une représentation vue de dessus, on finit inévitablement par voir beaucoup plus d’élément, ce qui pose la question de savoir ce qu’il faut regarder précisément. La multiplication des détails égare l’œil du spectateur, mieux, elle lui donne le choix. Ce regard reculé a alors pour conséquence de proposer une diversité, de ne plus insister sur une instance particulière dans l’image, en somme, de dé-hiérarchiser chacun des éléments constitutifs de la composition, à la manière d’une carte géographique. En empruntant à la géographie la dialectique de la cartographie, le peintre est alors en mesure de présenter une vision du monde qui se veut ouverte et neutre : non plus narrer une situation particulière, non plus assurer la légitimité d’un point idéalisé comme peuvent le faire la peinture religieuse, mais au contraire ouvrir le champ des possibles à la manière d’un atlas, afin de contribuer à la polyvocité des lectures. La peinture de Bruegel ne raconte pas d’histoire, elle décrit et réorganise la perception du monde. Rapporté à une carte géographique, ce dispositif donne une vision des choses qui n’appartient pas au commun des mortels : là où le souverain a besoin d’une carte pour saisir l’étendue de son royaume, là où l’état nécessite une carte pour résumer le territoire où sont respectées ses lois, il faut ajouter qu’un tel point de perception se rapproche de celui du divin. D’où la lecture désormais emprise d’une consonance politique, lorsqu’on se place dans le contexte du suzerain, comme le rappelle Buci-Glucskmann[3]. Nous remarquerons alors que la carte géographique, objet artistique en puissance, n’acquière ce statut esthétique qu’au cours du XXe siècle, où les nombreuses occurrences d’artistes l’exploitant, de Jasper Johns aux conceptuels, de Robert Smithson aux contemporains finissent presque par la banaliser. Si on peut raisonnablement croire de façon anticipée que ces derniers ont pu soulever des problématiques s’articulant autour de la société et de la structure du monde, il faut redonner à Bruegel le mérite d’avoir su proposer une nouvelle modalité de l’organisation picturale. Non pas que les cartes n’existaient pas avant lui, mais qu’une vision de la peinture souvent en vigueur à l’époque, puisse s’y associer en vue de s’affranchir du point de vue singulier et anecdotique, ce qui constitue à ce moment précis une innovation. Peut-être est-ce là que naît un pendant à une « esthétique du centre et de la périphérie ».
Une seconde étape charnière est initiée par l’émergence historique de l’abstraction au début du siècle dernier. En particulier lorsque des artistes comme Kasimir Malevitch, Vassili Kandinsky ou Piet Mondrian imposent une rupture radicale avec la nature, afin d’insister sur les velléités de l’espace de la peinture. Selon les artistes de « l’abstraction géométrique » la répartition structurée et préalable, de lignes, de points, de figures géométriques, justifie alors ce désir qu’ont les artistes de s’émanciper d’un principe de représentation ou de mimétisme. Ils privilégient alors la neutralité et l’objectivité de figures géométriques, comme c’est le cas avec l’Art Concret qui voit le jour en 1930. Les artistes « concrets » prônent un art de la rigueur qui témoigne d’un désir de compréhension et de maîtrise de l’abstraction, ne laissant plus de place à la contingence de la forme qui est alors contrôlée. Van Doesbourg, l’un de ses fondateurs, avait le souci de rendre objectif les moyens de la peinture en insistant sur l’aspect créatif de l’esprit comme manne essentielle à la réalisation picturale. Dès 1924, Van Doesbourg utilise des trames régulières comme des grilles ou quadrillage, ce qui lui permettra de positionner de manière euclidienne chacune des pièces compositionnelles. Les éléments modulaires définis par le quadrillage lui permettent de calculer les proportions, les positionnements ainsi que les dimensions, et ceci de manière justifiée. C’est le cas de Contre-Composition IV, peinte en 1924. L’utilisation de la grille est alors une caractéristique propre à Van Doesbourg, comme le montrent les « contre-compositions » des années vingt, ou plus explicitement Composition arithmétique de 1929-1930. Mais interrogeons-nous sur ce qu’implique plastiquement l’utilisation de la grille géométrique. A travers elle, nous pourrions a priori dire sans trop nous tromper qu’il n’y a absolument pas de centre qui vaille, puisque chaque « carré » jouit du même statut qu’un autre. Ce serait alors une sorte de configuration de la dé-hiérarchisation par excellence : rien ne prime sur rien, ni centre, ni périphérie. Idée renforcée lorsqu’on songe qu’en prolongeant les lignes à l’infini, l’apparence globale ne s’en trouvera que peu modifiée, comme si la grille faisait partie d’un ensemble beaucoup plus vaste et malgré tout identique. Pourtant, une loi extérieure à la consistance propre de la grille semble se dicter : on comprend en effet que pour que la grille ait une telle configuration, elle doit se soumettre à certains principes géométrico-mathématiques, qu’imposeraient par exemple la nécessité de respecter l’orthogonalité et la droiture des lignes. Autrement dit, la grille qui d’apparence semble accorder un statut équitable et démocratique au motif qu’elle compose, ne fait en définitive que se soumettre à une loi autre. Il nous faut donc en conclure que là où nous n’y voyons que diversité et égalité des chances, nous devons au contraire y percevoir soumission et subordination. La grille incarne l’ordre et la hiérarchie, et ce, de façon picturale.
L’exemple de Piet Mondrian est assez probant lorsqu’il est question d’aborder la grille comme une première métaphore de la structure urbaine. Comme on peut le constater sur New York 1941, Boogie Woogie, la composition de cette célèbre peinture pourrait se décrire comme un vaste entrelacs de lignes colorées. Ce qui signifie que seul le titre de l’œuvre nous permet de nous référer à une esthétique de la grille urbaine telle que peut l’évoquer la ville de New York, où les rues se croisent à angle droit. Ce n’est pas de façon anodine si dorénavant il est possible d’associer une imagerie géométrique, à un phénomène architectural reflétant assez bien le découpage ordonné de notre quotidien. La notion de grille renvoie explicitement à l’organisation urbaine telle qu’on la conçoit dans les sociétés occidentales. Mieux, elle renvoie aux différentes espaces sociaux, dessinés et structurés de façon à pouvoir contenir une population, à la discipliner comme l’illustre le principe du Panopticon relaté par Michel Foucault[4]. C’est justement par un tel rapprochement entre espace réel dans lequel nous nous mouvons, et espace pictural de la peinture qu’un artiste tel que Peter Halley a pu incarner bien plus tard que Mondrian puisqu’il commencera à exposer à partir des années 80, un art géométrique s’exprimant en termes de cellules et caractérisant comme il l’écrit[5], les prisons, les écoles et les hôpitaux. A travers sa peinture géométrique, Halley retrace une généalogie visuelle de l’organisation sociale et du développement industriel d’une culture occidentale qui dans son évolution, a semblé tendre vers une reconfiguration architecturale de chacun de nos espaces de vie sous l’égide de la rationalité et de l’ordre géométrique. Selon Halley, et d’après les travaux de Jean Baudrillard et de Michel Foucault, l’utilisation de la géométrie lui permet de mettre en relief de façon imagée les mécanismes architecturaux visant à canaliser et à contrôler une société donnée. Il s’interroge ainsi sur l’espace urbain en établissant une sociologie de la géométrie où l’utilisation de la grille souligne la progression urbaine et industrielle qui se déploie dans l’architecture de nos habitations.
En définitive, comment perçoit-on concrètement l’exercice de la hiérarchie, au travers de la géométrie ? Peut-on dire que toute représentation géométrique emporte avec elle une idée de la hiérarchisation ? Il semble vraisemblable de voir dans la géométrie l’expression mathématique d’invariants idéaux, et donc par définition, de correspondance à des lois préalables. La prétendue universalité d’une figure comme un cercle ou un carré, se lit en termes platoniciens comme la correspondance à une instance idéale supposée. Ainsi, par ce rapport transcendantal et linéaire à une forme de vérité supérieure, la géométrie se rapporte à une sorte de modèle préexistant. Ce serait alors une image de la hiérarchie qui s’exerce de façon « verticale » dans sa propension à appliquer un ordre « supérieur ». Face à cela, on peut opposer une esthétique où règnerait le chaos apparent tel qu’on peut l’envisager dans une abstraction d’obédience « lyrique », conformément à ce que matérialise Kandinsky, ou plus explicitement des artistes donnant corps à toute gestuelle expressive, à l’image d’un Pollock. C’est ce qu’écrivait Christine Buci-Glucksmann à nouveau, lorsqu’elle distingue un striage incarné par Mondrian, face à un lissage à la Pollock[6]. Le cas de l’artiste américain, et l’esthétique particulière d’une peinture qui n’éprouve ni centre ni périphérie, nous permet d’introduire à la suite de Buci-Glucksmann, des notions d’espace lisse et d’espace strié, empruntés à Gilles Deleuze et Félix Guattari, pour illustrer la dichotomie existante entre ces deux modes de conceptions de la distribution spatiale. Le concept d’espace lisse désigne un espace sans repère, sans bord pour le délimiter, sans dimension et sans variable. A l’inverse, le concept d’espace strié désigne un espace hiérarchisé, organisé, réglementé, conquis par l’ordre et la prédétermination[7], c’est un espace mesurable et quantifiable, évoquant une dimension que la fragmentation unitaire acquiert. Rapporté aux domaines de l’art, la conception de deux espaces distincts permet surtout de saisir deux régimes de distribution du plan, deux façons de le vivre.
La cartographie perceptible chez Bruegel, la ligne multiple et constamment insaisissable chez Pollock, soulignent cette opposition à la verticalité transcendantale, au profit de l’horizontalité immanente et symbolisant en quelques sortes la mise à plat, la mise au même niveau de chacune des occurrences se distribuant sur un tel espace. Les rapports de connexions sont infinis, les coexistences multiples, les parcours ou les « lieux » sont en puissance d’être suivis là où aucune règle préliminaire ne semble orienter l’espace. Nous en appellerons à ce que nous pourrions nommer une esthétique de la mise en réseau. Ce troisième moment dans notre approche qui, s’il ne possède pas véritablement de date historique hormis ce qu’on pourrait approximativement rapprocher de l’avènement de nos sociétés postmodernes à la fin des années 1970, serait une dernière étape arbitraire qui une fois rapportée au domaine de la production plastique d’aujourd’hui, permet de relire à la fois Bruegel et Pollock comme les instigateurs officieux d’une logique hautement contemporaine. Car effectivement, « faire la carte », c’est promouvoir la diversité des échanges, des possibilités de lecture et la souplesse avec laquelle il devient possible de partir puis de revenir. C’est aussi s’affranchir d’un principe de ressemblance, puisque ce qui incombe dans une carte-réseau, c’est l’instauration d’une logique de la connexion. A une époque lisible en termes de vitesses, de mouvements et de flux divers, penser le réseau apparaît souvent comme une échappatoire des plus plausible.
A cet égard, l’artiste contemporain Thomas Hirschhorn, qui n’officie pas dans le domaine de la peinture, mais dans la tridimensionnalité, constitue un cas particulièrement exemplaire. Par des installations souvent tentaculaires et foisonnantes, dans lesquelles sont juxtaposés une multitude de documents d’origine aussi diverses que des photographies de la presse people, des revues politiques ou des ouvrages philosophiques, Hirschhorn parvient à mettre en place un jeu complexe de ramifications, constituant alors une sorte de réseau tridimensionnel saturé d’informations et de mises en relation en tout genre. Comme en témoigne l’œuvre Jumbo Spoons and Big Cake (Chicago, 2000), qui est clairement envisagée comme un réseau de connexions, ce qui constitue certainement un moyen plastique plus adéquat pour dévoiler les ramifications multiples qu’entretiennent entre eux chacun des aspects qui peuplent notre monde. Connecter génère des assemblages, des juxtapositions d’éléments qui en s’additionnant indéfiniment, finissent par reproduire plastiquement une atmosphère d’intense profusion. Cette logique de l’addition finit par absorber toute constatation périphérique dans son intégrité, des opinions, des points de vue, ou une attitude imprévisible du spectateur. En fonctionnant sur le mode de l’accumulation, de la même manière qu’une sorte de trou noir, l’oeuvre parait chaotique. Mais l’exigence qu’implique cette loi de la connectivité cache en réalité une logique interne beaucoup plus probante qu’un chaos ineffable. L’œuvre prise dans son ensemble est privée de hiérarchie, position qui est claire chez l’artiste qui indique honnir toutes ses formes[8]. Hirschhorn indique à cet égard que sa volonté était de construire les choses selon un « esprit en deux dimensions », ce qui l’autorise à voir l’œuvre selon toutes ses orientations, précisément à la manière d’une carte. Le réseau semble répondre à une demande, mais ne peut-on convenir qu’il se constituerait surtout comme la réponse à un programme plus vaste ? Qu’implique en définitive l’apport du réseau ? A quoi répond-t-il ? Nous avons partiellement répondu à ces questions, en insistant sur une composante essentielle du réseau : il met les choses à plat et favorise la diversité, la multiplicité, l’échange, contrairement à un espace de distribution ordonné, pour lequel seul un langage correspondant semble capable de l’appréhender. En somme, le réseau promeut la souplesse et la liberté de déplacement, là ou une grille par exemple, semble illustrer une application stricte à un ordre supérieure. C’est alors sans surprise que l’on soulignera l’aspect profondément engagé d’un artiste tel que Hirschhorn : par une mise en place du réseau, il sera surtout question de répondre à une société codifiante et planifiée, telle qu’elle se présente aujourd’hui dans une logique de consommation de masse et de marche à la mondialisation. En favorisant le mouvement permanent, plutôt que la rigidité d’une signification, le réseau relève d’une sorte d’infiltration dans la réalité et opère ainsi une forme de résistance, de la même façon qu’une guérilla se dissimule dans le paysage local, au milieu du peuple même.
On pourrait dire que l’instauration d’une relation hiérarchisée, par un centre et une périphérie, impose l’assujettissement analytique et ordonné afin de répondre de façon efficace à un problème donné. De ce point de vue, la hiérarchie serait un idéal à viser, mais il omettrait très certainement la diversité et l’incohérence du mythe de la démocratisation excessive d’instances qui inévitablement ne se ressemble pas les unes les autres. Pour comprendre la nécessité de résistance qu’ont pu éprouver les artistes à l’égard de la notion de hiérarchie, il faut partir du principe que chaque unité du monde est indépendante et singulière : on ne peut pas prétendre réduire sous un ordre unique, des choses dont les conditions d’existence diffèrent. En effet, pourquoi vouloir réduire au même point, au même degré de signifiance, une périphérie qui de façon ontologique est fondamentalement marqué par la diversité et la richesse ? Pourquoi vouloir coordonner et amoindrir là où la contingence et la profusion marquent la créativité comme en témoigne le réseau Internet ? La distinction que nous avons pu faire entre un ordre de correspondance mimant une loi générale, face à un principe cartographique permettant de saisir le monde selon ses aspérités propres, nous rappelle que tout ne doit pas être nécessairement totalisé sous l’angle de l’intelligence rationnelle et analytique. Bruegel, Pollock et Hirschhorn s’inscrivent alors comme des artistes étant au plus près – parfois paradoxalement – de ce qui est réellement, comme l’écrit Michel Serres lorsqu’il s’interroge sur la distinction à faire entre raison et existence, et sur lequel nous terminerons : « Pourquoi ne dessinons-nous jamais, en effet, les orbites des planètes, par exemple ? Parce qu’une loi universelle prédit leurs positions ; qu’aurions-nous à faire d’un routier, dans ce cas de mouvements et de situations prévisibles ? Il suffit de les déduire de leur loi. Aucune règle, au contraire, ne prescrit la découpe de ces rives, le relief des paysages, le plan du village de notre naissance, le profil du nez ni l’empreinte du pouce… »[9]
[1] Christine Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art, Paris, Galilée, 1996.
[2] Julien Verhaeghe, « Vers une photographie du corps micropolitique, Andreas Gursky », in Photographie et corps politiques, sous la direction de François Soulages, Marc Tamisier et Catherine Couanet, Paris, Klincksieck, 2007.
[3] Christine Buci-Glucksmann, Op. cit., « Si bien que ce regard sans centre ni horizon définit d’emblée un espace abstrait-concret et un va-et-vient permanent entre regard esthétique et emprise politique. Une des généalogies possibles du « regard panoptique » selon Foucault, bien avant son origine classique. Car pour tout voir, de toutes les manières, pour surveiller et contrôler le monde, une carte suffit ». p. 24.
[4] Michel Foucault, Surveiller et Punir, Gallimard, Paris, 1975. « tout un type de société se dessine à travers l’invention du Panopticon de Bentham : notre société n’est pas celle du spectacle mais celle de la surveillance : le Panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition […]On en connaît les principe : à la périphérie un bâtiment en anneau ; au centre une tour ; celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l’anneau ; le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l’épaisseur du bâtiment », p. 233.
[5] Peter Halley, Crise de la géométrie et autres essais 1981-1987, ENSBA, 1992, p.57 à 71.
[6] Christine Buci-Glucksmann, « Une abstraction à l’époque du virtuel », in Ligeia, n° 37-38-39-40, oct. 2001-juin 2002, p. 33.
[7] Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, Minuit, 1980, « l’espace lisse est directionnel, non pas dimensionnel ou métrique. L’espace lisse est occupé par des évènements ou hécceités, beaucoup plus que par des choses formées et perçues. C’est un espace d’affects, plus que de propriétés, […]. Alors que dans le strié les formes organisent une matière, dans le lisse les matériaux signifient des forces ou leurs servent de symptômes. C’est un espace intensif plutôt qu’extensif, de distance et non pas de mesures », p. 588.
[8] T. Hirschhorn, « Alison M. Gingeras in conversation with Thomas Hirschhorn », in Thomas Hirschhorn, Paris, Phaidon, 2004, « I do hate hierarchy, every hierarchy », p. 22.
[9] Michel Serres, Atlas, Paris, Flammarion, 1996, p. 17.

« Il y a non seulement d’étranges voyages en ville, mais des voyages sur place : nous ne pensons pas aux drogués, dont l’expérience est trop ambiguë, mais plutôt aux véritables nomades. C’est à propos de ces nomades qu’on peut dire, comme suggère Toynbee : ils ne bougent pas. Ils sont nomades à force de ne pas bouger, de ne pas migrer, de tenir un espace lisse qu’ils refusent de quitter, et qu’ils ne quittent que pour conquérir et mourir. Voyage sur place, c’est le nom de toutes les intensités »[1].
Dans l’esprit de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, le nomadisme décrit une attitude visant à s’extraire des dispositifs codifiants et normalisants, imposés par le maillage des structures sociales, politiques et historiques. Il s’agit alors de sortir des sentiers balisés au profit d’un parcours fuyant, non pour échapper à la vie, mais au contraire pour produire du réel, « trouver une arme »[2]. Le voyage immobile que décrit donc le nomadisme, vise à travers des « lignes de fuite » à instaurer dans l’optique du devenir, un rapport au monde permettant de penser le nouveau, l’actualité, notre actualité. Or ce qui s’applique à l’échelle de la philosophie s’avère sans doute nous fort utile, une fois rapporté au monde de l’art. En effet, si le voyage immobile suppose une posture créatrice, dans son éloignement à l’égard des prescriptions dictées par le monde, la société, les traditions, ne revient-il pas aux artistes d’être les premiers nomades ? C’est ce qui rend nécessaire l’étude d’une œuvre telle que celle de Francis Alÿs, lui qui semble légitimement se réclamer d’un certain « nomadisme », par l’incessante mise en œuvre dans ses déambulations d’une logique deleuzienne d’oscillation entre la différence et la répétition. Parcourant les rues de certaines mégapoles, et plus particulièrement celles de Mexico, l’artiste fait écho à la figure du flâneur contemporain, tandis que jamais il ne cesse d’en faire quelque chose de nouveau. Ses pratiques de l’espace semblent de prime abord tout à fait vaines, elles qui favorisent une lecture initiale parfois teintée d’humour, tant elles paraissent insolites et parfois inutiles. Il faut croire pourtant qu’elles sont constamment le motif d’une circulation foisonnante d’intensités – pour reprendre le mot de Deleuze et Guattari – contribuant en cela à brasser les possibles et les virtualités susceptibles de laisser poindre une émergence. En cela, Alÿs permet de penser le mouvement à partir d’une relative immobilité, de songer à ce qui jaillit tel un saut qu’il effectuerait sur place, là où un tel saut nécessite toujours que l’on fournisse un certain effort.
C’est également en cela que le voyage sur place suppose toujours une manière d’opérer une action sur le monde, puisqu’en le triturant, en le manipulant, on le module aussi dans l’insistance du faire et de la praxis. Ainsi, alors que le monde continue inlassablement de se mouvoir, il semble que l’activité de la marche et à travers elle, la pratique de l’espace comme nous le montrera Alys, permette d’inférer une autre manière de connaître le monde, en l’accompagnant dans ses flux et ses devenirs, en faisant corps avec lui.
Une critique du flâneur contemplatif
Réalisé en 1991-1992 en collaboration avec Felipe Sanabria dans les rues de Mexico, The Collector consiste en une série de marches dans lesquelles l’artiste tire derrière lui un petit chien métallique puissamment aimanté, comme s’il s’agissait d’un jouet ou d’un animal domestique. Naturellement, tout un ensemble d’objets métalliques disparates viennent se glaner au chien. Il ne reste plus qu’à relever les fragments et à observer, comme l’écrit Thierry Davila, pour « imaginer le paysage urbain »[3]. Renvoyant donc à une certaine visibilité de la ville par ses objets aléatoirement jonchés sur ses sols, l’arpenteur qu’est Alÿs, devient en quelque sorte le détective des aspirations oubliées par la mégapole, à tel point qu’à partir de ces diverses « circulations », d’objets ou de sa propre personne, on est en droit de se demander si le véritable motif de ce qui est ici entrepris, n’est pas plutôt la saisie par les imaginaires collectifs d’une certaine image de la ville.
Un autre travail, dont le protocole est quelque peu similaire, permet d’insister sur le rapport à ce qui n’est pas forcément perceptible de prime abord, comme pour insister sur une lecture de l’espace qui viserait à récupérer les flux rejetés par la ville. Ainsi le projet Magnetic Shoes, réalisé à La Havane pour la première fois en 1994, consistait également en déambulations urbaines munies cette fois de chaussures aimantées. Outre la concrétion d’objets métalliques, il faut s’imaginer le poids que peuvent faire de telles chaussures, et le rapport d’inhérence à l’égard du sol. Comme le relève à juste titre Thierry Davila, ces promenades renvoient à une certaine horizontalité, dans son addition des « indices d’une vie au ras du sol, horizontale, basse »[4].
L’hypothèse que nous voulons toutefois explorer consiste à dire que ce type de marche, ponctué par le port de telles chaussures ou par la collecte d’éléments a priori insignifiants, suppose une première insistance à l’égard d’une forme d’effort, de travail, en ce que cela peut induire du nouveau, voire une réflexion portée à l’adresse des principes de genèse de l’événement. L’arpenteur est celui qui dans l’esprit du devenir adopte un regard changeant, un rapport au monde qui ne cesse de se régler et de se dérégler pour mieux en percevoir les rythmes. Ce n’est plus d’un regard contemplatif et inutile dont il s’agit, mais d’un regard qui se module et se moule aux aspérités du réel.
Aussi est-ce ce qui permet de penser le voyage immobile chez Alÿs comme une critique du flâneur benjaminien ou baudelairien, dans l’insistance faite à l’égard de cette idée d’effort. Il ne s’agit pas de perdre ou de prendre son temps, mais de contribuer à une logique dans laquelle celui qui travaille n’arrive pas forcément à bon port, là où celui qui se contente du moindre effort, peut en revanche y parvenir. Alÿs écrit ainsi que ce qui l’anime est décrit par ces deux principes symétriques, dans leur interrogation aux principes de production[5]. La flânerie peut pourtant être une forme de travail, mais à la concevoir en ce qu’elle repose sur une activité nonchalante et décontractée, on aurait presque envie de croire qu’elle signifie une attitude contemplative et désintéressée à l’égard de ce qui surgit. Si Alÿs s’inscrit pourtant dans une logique de retrait face aux conceptions quantitatives et consuméristes vouées à l’efficacité, c’est davantage pour souligner la permanence du faire qui jamais ne fait l’impasse sur l’événement. Ce qui surgit, ce qui arrive dans la pratique, le fait à chaque instant ; rien n’est donc vain mais, surtout, l’individu qui se meut dans l’espace urbain à la manière d’Alÿs, le fait dans un rapport interactif : il donne autant qu’il reçoit.
Le surgissement de l’événement
C’est dans le rapport d’immersion que la marche en tant que travail prend son sens, car elle autorise l’émergence de l’inattendu. Soulignant à nouveau la critique du flâneur baudelairien et surréaliste, Cuautémoc Medina nous dit d’Alÿs que son approche ne consiste pas en une sorte de « voyeurisme social »[6]. Plutôt que d’assister passivement au spectacle collectif et urbain, ici le flâneur est avant tout un acteur, non un spectateur. Or Alfred North Whitehead nous rappelait déjà que c’est l’observateur qui crée l’événement, tout comme c’est en connaissant historiquement que l’on crée l’histoire, car l’observateur est dans l’événement. Ainsi, lorsque chez Baudelaire le flâneur est le spectateur des activités de la foule dans laquelle il se fond, entretenant un rapport fétichisé et rêveur, donc en cela proche du voyeurisme que couvre son anonymat, jamais il n’est question d’interférer avec ce qui arrive. Au contraire de l’approche d’Alÿs qui se rapportant à une logique de l’effort ou de l’agir, s’immerge et assimile l’observateur à l’acteur, donnant ainsi une visibilité contemporaine à la figure du flâneur, comme lorsque ce dernier s’insère dans le milieu environnant que dans le même temps il expérimente.
Le voyage immobile d’Alÿs suppose ainsi qu’il soit acteur dans les espaces qu’il parcourt, tout en modifiant instantanément ces espaces, et de fait, la perception de ces espaces. L’éthique du nomade supposait précisément cela, que l’on s’attache à un entre-deux suggérant une temporalité double, dans son hésitation entre ce qui fait que l’on s’attarde, et ce qui fait que les choses passent. Le temps de l’effort supposant aussi l’inlassable répétition, fait ainsi face au temps de l’érosion du monde, inscrivant l’arpenteur nomade dans une tension qui demande sans cesse que l’on soit attentif tantôt à l’un, tantôt à l’autre. Deleuze nous rappelle que « la répétition est une condition de l’action »[7], ce qui en appelle par l’agir, à une temporalité trouble compressée entre un passé et un présent toujours en métamorphose[8], là où ce qui est produit, « l’absolument nouveau lui-même »[9], n’est rien de moins qu’une « nouvelle répétition ». Tension que l’on perçoit également dans la figure de l’intempestif nietzschéen, lui qui se doit de s’identifier à l’histoire et au passé, pour mieux s’élancer vers une sorte d’au-delà du présent.
Deleuze nous renvoie également à la thèse de Hume, selon laquelle « La répétition ne change rien dans l’objet qui se répète, mais elle change quelque chose dans l’esprit qui la contemple »[10]. Or Francis Alÿs, lui qui crée ses répétitions, se place dans la position de celui qui est à la fois l’instigateur et le contemplateur de ces répétitions. Il se place ainsi exactement sur le lieu du paradoxe, qui voit celui qui agit, et se regarde agir, comme s’il réalisait un pas de côté pour mieux appréhender le mouvement qu’il contracte. Position qui en outre est celle qui favorise l’éthique de l’intempestif, puisque celui qui réalise ce pas de côté est dans l’impératif de réaliser un contretemps, en vue d’un « temps à venir » placé sous d’autres auspices.
Ces « temps à venir » selon les mots de Deleuze[11], sont des temps autres, des temps nouveaux. Par conséquent, c’est l’idée de ce qui peut survenir qui est à prendre en compte dans le fait d’enclencher une activité prise dans le temps de la répétition, ce qui n’empêche pas de penser ces temporalités à partir de l’espace. Ainsi, en effet, la répétition présume que l’on s’attache à un territoire, que l’on y reste cloisonné, quand l’invitation au voyage suggère que l’on s’y écarte, que l’on explore de nouvelles contrées afin d’y mesurer la différence, toujours susceptible d’advenir. Surtout, le voyage immobile permet de distinguer le surgissement d’un événement auquel on participe en nous affectant directement, d’un accident dont on ne serait que le spectateur.
C’est ce qu’entreprend Francis Alÿs en déplaçant la figure du flâneur au cœur même de la catastrophe à venir. L’artiste explique cela dans Bottle, surnom qu’il donne à un travail intitulé If you are a typical spectator, what you are really doing is waiting for the accident to happen[12]. Dans cette vidéo réalisée en 1996, une caméra suit une bouteille de plastique vide, déambulant dans l’espace urbain au gré du vent. Initialement, Francis Alÿs voulait qu’il n’y ait aucune interaction entre la caméra et les événements encourus par la bouteille, filmant sa dérive et comme il le dit, attendant qu’un accident surgisse[13]. Il est ainsi vrai par exemple que des enfants ne remarquant pas la caméra, s’empressent de frapper du pied la bouteille, qui est invitée à suivre un parcours hasardeux. Cependant, l’œil rivé sur sa caméra, Alÿs poursuit la bouteille à travers les rues, et ne voit pas une voiture qui le percute, de façon suffisamment conséquente pour faire voler sa caméra qui continue à filmer. Heureusement sans gravité, l’idée est que là où le spectateur s’attendait à ce que quelque chose se produise, c’est finalement ce même spectateur qui fait l’objet d’un accident. Ici l’action d’observer, a interféré avec le cours des choses, faisant de Bottle un travail charnière dans l’œuvre d’Alÿs, puisque dès lors, il n’aura de cesse que de penser à travers ses interventions, à l’implication directe de l’homme dans son milieu.
Le paradoxe de la praxis
Un autre travail permet également d’insister sur le rapport entre l’activité d’un individu dans le milieu où il évolue, avec la possibilité de laisser émerger un « accident ». Re-enactments, réalisé en 2000, nous montre deux vidéos dans lesquelles l’artiste achète une arme à feu, puis est filmé déambulant dans les rues de Mexico, l’arme au poing ; la première vidéo relate alors l’événement tel qu’il s’est vraiment déroulé, jusqu’à son arrestation violente par les forces de l’ordre, là où la seconde vidéo, filmée le lendemain, est une exacte réplique de la première, hormis le fait que cette fois, les policiers sont de connivence. Francis Alÿs voulait alors questionner la manière avec laquelle le paysage médiatique contemporain est à même de déformer et dramatiser la réalité immédiate du moment, en particulier lorsque cette « réalité immédiate » se déroule dans le temps du présent, dans cette temporalité qui est en train de survenir juste sous nos yeux, comme l’est une performance, ce que relate précisément la première vidéo.
Il est ainsi intéressant de reconnaître dans le travail de Francis Alÿs l’importance de cette idée de répétition, une nouvelle fois, conférant au présent « réel », celui qui voit naître dans l’ordre de l’imprévisible, l’accident. C’est un moyen de nous inscrire dans la dialectique entre action – dans l’idée que quelque chose survienne – et le jaillissement inopiné de l’accident, évoquant une certaine fatalité, comme si les choses étaient écrites d’avance, indépendamment du fait humain. Ce rapport entre l’action et la manière avec laquelle les événements se mettent en place met en avant une paradoxale circularité, puisqu’on retrouve la vulgate marxiste dans laquelle les hommes à l’origine des événements, sont par ailleurs conditionnées par l’émergence de ces événements.
Or la circularité est aussi un moyen d’insister sur un certain présent de l’œuvre, ce qu’irrémédiablement laisse penser le temps des nomades, qui n’ont « ni passé ni avenir, mais seulement des devenirs »[14], induisant une sorte « d’hypnose de l’acte en lui-même, un acte qui serait pur flux, sans début ni fin »[15], comme le rappelle une autre des œuvres de Francis Alÿs, Song for Lupita, réalisée en 1998. Dans cette dernière, une femme remplit indéfiniment de l’eau dans un verre, puis recommence dans l’autre sens en remplissant à nouveau le premier verre. Les répétitions font du rythme qui altèrent la perception du temps qui passe, une manière de le diluer[16]. Surtout, cela permet d’induire un certain rapport à l’idée de travail et de production, notamment dans l’appel à l’efficacité qu’insinue toute activité rétribuée. L’absurde de la répétition est en cela un contrepoids formulé à l’encontre d’un certain dogme rationaliste qui voit dans tout effort, une finalité parfaitement descriptible.
L’œuvre exemplifiant au mieux cette interrogation à l’adresse d’une notion de travail serait dans cette optique Paradox of Praxis, réalisé en 1997 dans les rues de Mexico. Ici, il s’agit de pousser toute une journée un bloc de glace qui au départ, est assez conséquent, mais s’amenuise au fil des heures, pour devenir une balle, et enfin une flaque d’eau. On conçoit volontiers que pousser un tel bloc n’est pas un travail de tout repos, pourtant il ne conduit strictement à rien. Alÿs y voit ici une manière de s’opposer au principe de progrès, car ce qui prime est davantage le temps du faire, le temps du processus, que le temps de la synthèse ou de la fabrication[17]. Ajoutons à cela un rapport à la rédemption que suppose un tel effort, ce que confirme l’idée constante que malgré l’incongruité du geste, une foi aveugle laisse croire que quelque chose doit survenir, quelque chose doit faire sens.
De fait, l’absence de sens semble renvoyer à la nécessité de croire qu’il va tout de même survenir quelque chose, ne serait-ce qu’au cœur du temps de réalisation de l’œuvre. La notion d’effort telle que la met en pratique Alÿs est en cela ambivalente, elle renvoie à une dualité tragique de l’attente cumulée à l’absolue nécessité de croire, de savoir, comme peut nous le montrer Clément Rosset à partir de Nietzsche et Schopenhauer. Mais l’effort est aussi le propre du Corps sans organe deleuzien, dans l’idée du dépassement continu de ce qui nous compose déjà, et donc dans l’optique d’une fuite vers laquelle on voudrait tendre, là où l’effort justement signifie la nécessité de perdurer, d’insister, de durer dans le devenir.
Le voyage immobile où une autre manière de connaître le monde
S’inscrivant sur le terrain des philosophies interrogeant la notion de pratique, le voyage sur place par Francis Alÿs suppose une manière différente d’être, à l’égard de ce qui passe, notamment face à l’histoire et en définitive, au monde contemporain. Qu’implique en effet le surgissement de l’événement par la répétition ? Pourquoi ainsi tendre vers la production praxique de la différence ? C’est que le voyage immobile, alors qu’il était une manière de penser le monde, est tout autant une façon de le connaître, ou plutôt, de le vivre. Le rapport immersif que suppose le voyage immobile a quelque chose en effet d’une modulation plastique. Le monde nous enseigne certaines informations qui en retour, sont ingérées de telles manières à ce qu’on les réinjecte à nouveau, et ainsi de suite. On retrouve en cela les lois de la communication énoncées par l’école de Palo Alto, influencée par le courant cybernétique qui pose comme premier postulat les principes d’interactions actuelles et « intempestives » de l’homme avec son environnement, constituant en cela une approche systémique dans laquelle l’observateur est inclus dans l’observation. C’est ce qui arrive à Francis Alÿs, et c’est également ce qui nous permet de dire qu’il infère à l’échelle de l’art, une autre manière de connaître le monde.
Si celle-ci s’avère propice, c’est qu’elle permet de tenir compte de ses flux, de concilier les devenirs coalescents qui traversent notre univers, car l’observateur-acteur est toujours à même de moduler sa propre présence en fonction de ce qu’il observe ; en cela, c’est aussi ce qui laisse penser qu’Alÿs pose les jalons de façon plastique à une éthique du Connaître et du Percevoir, dans l’idée que seul le voyage immobile permet d’appréhender le monde extérieur, tout en se regardant soi-même, pour reprendre une expression de Vico[18].
Ainsi, dans le paradoxe du voyage immobile, on y discerne la dualité qui se joue entre l’être et le non-être, entre le moment où l’on occupe un lieu là où simultanément on s’en extirpe, entre ce qui reste et ce qui se meut. Peut-être alors est-ce dans l’un de ses travaux intitulé Narcotourist datant de 1996, que l’on retrouve de façon exemplaire cette idée de l’entre-deux. Ici, l’artiste œuvre dans l’espace urbain tout en ayant la tête ailleurs. Invité dans la ville de Copenhague, Alÿs entreprend le temps d’une semaine de parcourir la ville, chaque jour en ingurgitant une drogue différente, modifiant autant que faire se peut sa perception individuelle, ses actions, et même sa capacité à être maître de lui-même. C’est ce qui fait qu’il s’inscrit dans l’ordre d’un devenir-autre deleuzien, essence même du nomadisme toujours porté vers un ailleurs. C’est également en cela que l’art nous montre qu’il peut très bien s’avérer propice à une lecture du monde, puisqu’en effet, sans l’idée de voyage sur place, tout un ensemble de questions ne connaîtraient jamais de réponses, dès lors qu’est occultée une distance critique propice à un regard extérieur et objectivé. Comment par exemple penser le contemporain, alors que nous en faisons partie ? Comment penser l’homme, alors que c’est ce que nous sommes ?
[1] Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 602.
[2] Ibid., p. 60.
[3] Thierry Davila, Marcher, Créer, Paris, Editions du Regard, 2002, p. 92.
[4] Ibid.
[5] Francis Alÿs, « Interview with Russell Ferguson », in Francis Alÿs, Phaidon, 2007, « Parfois faire quelque chose ne conduit à rien », « Parfois ne rien faire conduit à quelque chose », notre traduction, p. 15.
[6] Cuautémoc Medina, « Survey », in Francis Alÿs, op. cit., p. 76.
[7] Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968, p. 121.
[8] Ibid.
[9] Ibid., p. 121.
[10] Ibid., p. 96.
[11] Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962, p. 122.
[12] « Si vous êtes un, véritable spectateur, ce que vous faites vraiment est d’attendre que l’accident ne survienne », « Interview with Russell Ferguson », op. cit., p. 14.
[13] Ibid., p. 15.
[14] Gilles Deleuze, Félix Guattari, op. cit., p. 39.
[15] Francis Alÿs, « Interview with Russell Ferguson », op. cit.., p. 15.
[16] Ibid., p. 45.
[17] Ibid., p. 48.
[18] Gianbattista B. Vico, Principes de la philosophie de l’Histoire, (1744), tr. Fr, J. Michelet, La Haye, G. Vervloet, 1835, t. I, p. 162, « L’œil voit tous les objets extérieurs, et ne peut se voir lui-même dans un miroir ».