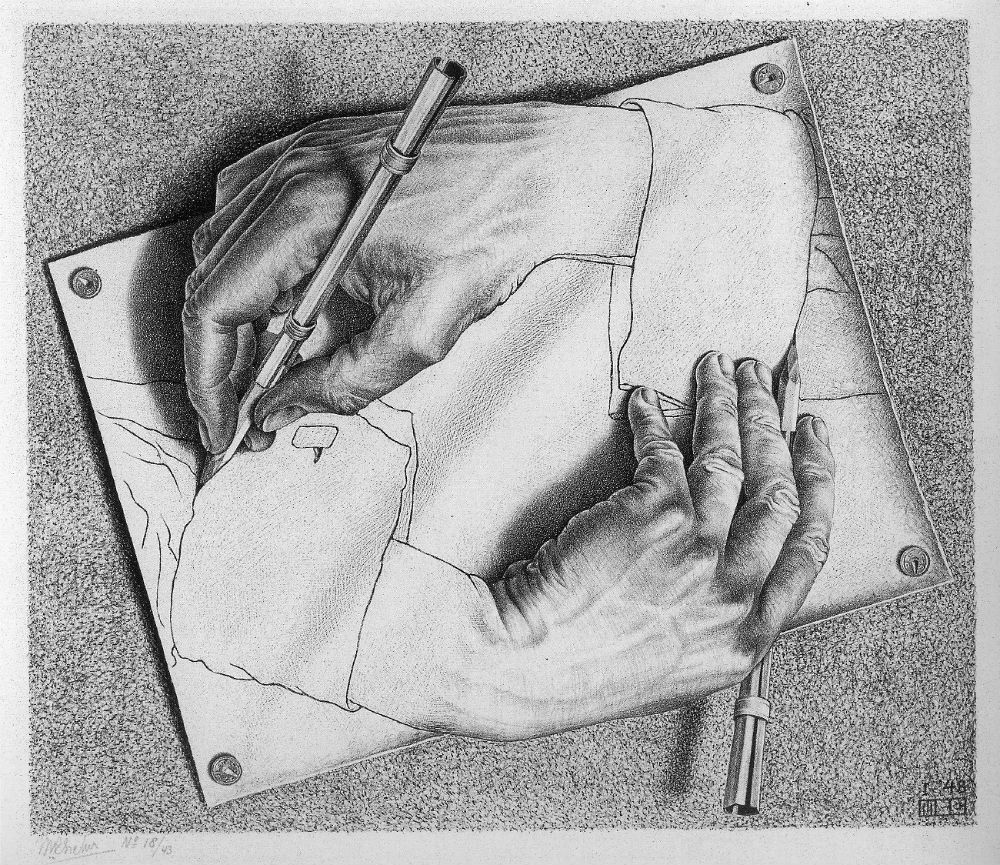
Lorsqu’une étude se porte sur des systèmes organisés dans lesquels se meuvent les flux, les rapports de force et les contradictions, il arrive assez souvent que l’on fasse appel aux métaphores de la vie ou de l’organisme. Or si les métaphores peuvent avoir un rôle constitutif dans le développement des idées et de la pensée scientifique, il reste qu’elles ne reflètent pas toujours les articulations conceptuelles propices à l’émergence de nouvelles perspectives, surtout dans l’optique d’une connaissance tenant compte de ses ouvertures et de ses antagonismes. C’est ce qui rend nécessaire le recours à la pensée complexe, en ce qu’elle permet justement de mettre en avant dans le phénomène de la vie, des principes investissant le champ des contradictions et des complémentarités. Suivant le paradoxe de l’un et du multiple, du tout et des parties, la complexité dans ce qu’elle a de favorable à une intelligibilité de la vie, nous invite à interroger ce qu’il adviendrait quant à l’art et de l’esthétique : que peut en effet la pensée complexe lorsque l’on considère des œuvres d’art ? Si la vie et l’esthétique devaient partager certains principes, s’ils devaient avoir un mode de fonctionnement commun, comment cela se traduirait-il ?
Ainsi, nous appuyant sur la complexité notamment à partir du second volume de la Méthode d’Edgar Morin, sous-titré La vie de la vie[1], il s’agira de mettre en avant les antagonismes inhérents au phénomène de la vie, dans l’optique de les confronter au régime écologique dans lequel s’inscrivent les œuvres d’art ; ce qui en outre nous conduira à questionner ce que pourrait être l’esthétique dans sa proximité à l’égard des mécanismes de la vie.
Introduction à la pensée complexe
La pensée complexe proposée par la Méthode entreprend de considérer tout objet, toute science, toute approche dans un rapport d’unité, tout en conservant à l’esprit un souci d’ouverture. Ainsi, se poser la question « qu’est-ce que la vie ? », ou se poser la question « qu’est-ce que l’esthétique ? », est omettre la nature diverse, contradictoire, événementielle, mais aussi subjective, connective et sans cesse portée vers l’inconnu, que suppose toute complexité. Penser la vie, est aussi penser la brèche qui lui est inhérente, c’est-à-dire « la faille qui brise et fait éclater ce que l’on croyait monolithique et stable. Mais c’est aussi l’enveloppe qui se déchire et laisse échapper son contenu, en même temps qu’elle permet à de nouveaux contenus d’affluer en son intérieur. »[2]
Mais qu’est la pensée complexe, et plus précisément, la pensée complexe de la vie ? On ne peut prétendre répondre de façon exhaustive, comme l’écrit Edgar Morin : « Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. […] La complexité ne saurait être quelque chose qui se définirait de façon simple et prendrait la place de la simplicité. La complexité est un mot problème et non un mot solution. » [3]. Cependant, il reste que deux idées importantes reviennent dans la pensée complexe, celle de l’englobement ou du retour vers soi-même et celle du tissage et de l’ouverture. Englober signifie la possibilité que possède toute chose de se retrouver contenue, comprise, insérée dans un ensemble ou une logique plus vaste, comme pour maintenir ou perpétrer la vie. Cela signifie aussi le fait de se retrouver constamment à l’origine ou comme le point intermédiaire dans une dynamique plus étendue. Edgar Morin évoque par exemple la notion de cycle, soulignant le fait d’alimenter et dans le même temps, le fait d’être alimenté[4]. Réciproquement, tisser implique que les diverses sciences, que les diverses forces, que les sphères qui s’opposent, soient tout de même unies, tissant des liens et ainsi donc, forment une chaîne. Ainsi, englober et tisser est selon Morin, penser le cycle, en ce qu’il s’accorde avec la chaîne, ce qui lui permet d’insister sur la boucle, dans le contexte d’une pensée écologique[5].
Ce système mis en place, où apparaissent contradiction et complémentarité, « invariance et horlogerie »[6], constitue donc une organisation, notion première de la complexité telle que Morin la met longuement en avant dans le premier volume de la Méthode[7]. Plus précisément, il s’agira d’envisager une éco-organisation, afin d’insister sur la dimension écologique de cette organisation, là où une écologie suppose l’interaction de ses éléments, la mise en jeu des conjugaisons et des contraintes, qui finalement, forment un système. C’est aussi ce qui permet de dire qu’une pensée complexe est une pensée de la Physis dans l’idée de décrire la force mystérieuse et croissante qui anime le vivre, qui laisse se déployer la nature.
Dès lors, en vue de mettre en évidence cette force à l’œuvre, Edgar Morin n’a de cesse que de déployer les contradictions et les complémentarités de l’éco-organisation. Il faut cependant se garder de penser cette « contradiction productive » chez Morin, dans l’esprit de la dialectique hégélienne où, rappelons-le, les contradictions se dépassent dans une synthèse. Edgar Morin refuse l’idée de synthèse, en ce qu’elle semble constituer une troisième « solution », autonome et déterministe. Il préfère le terme de dialogique, privilégiant la complémentarité malgré, ou en vertu de l’antagonisme.
Précisons que ce principe dialogique, en ce qu’il entreprend de dépasser la dialectique hégélienne, suppose aussi le dépassement du « troisième terme », puisqu’il s’agit davantage de proposer une multitude de solutions possibles. La dialogique est la recherche du compromis – avec toute la flexibilité que suppose cette notion – bien plus que la recherche d’une solution définitive. Ainsi, penser la complexité dans son rapport dialogique nécessite aussi que soit mise en œuvre une logique de l’immensité des possibles, de la complexification. La complexité est donc explosive, tourbillonnaire, et promise à un bouillonnement de vie[8] ; c’est précisément cette part d’incertitude et d’intensité profusionnelle qui conduit au principe vital, insistant dans l’esprit du compromis, sur l’aspect créateur et adaptatif : le compromis est une autre voie, mais pas nécessairement ce qu’on pourrait nommer une « solution ». Il suppose que l’on crée quelque chose de nouveau, et dans le même temps, que l’on s’adapte.
En effet, l’éco-organisation, en tant que pensée de la Physis, suppose la création, la naissance, l’évolution, la transformation. La vie est l’exact opposé de tout immobilisme ou fixité, elle suppose au contraire le mouvement inventif, l’émergence du nouveau, en contradiction et en complémentarité avec ce qui pourtant la stabilise. L’organisation cyclique, ou réorganisation, laisse croire à une éco-organisation créatrice et productive, comme Morin l’énonce : « la qualité éco-réorganisatrice la plus remarquable n’est pas d’entretenir sans cesse dans des conditions égales, à travers naissances et morts, l’état stationnaire du climax ; c’est d’être capable de produire ou d’inventer de nouvelles réorganisations à partir de transformations irréversibles survenant dans le biotope ou la biocénose. Ainsi nous apparaît la vertu suprême de l’éco-organisation : ce n’est pas la stabilité, c’est l’aptitude à construire des stabilités nouvelles ; ce n’est pas le retour à l’équilibre, c’est l’aptitude de la réorganisation à se réorganiser elle-même de façon nouvelle sous l’effet de nouvelles désorganisations. Autrement dit, l’éco-organisation est capable d’évoluer sous l’irruption perturbatrice du nouveau, et cette aptitude évolutive est ce qui permet à la vie, non seulement de survivre, mais de se développer, ou plutôt de se développer pour survivre. »[9]
Enfin, Morin insistera sur la nature adaptative de l’éco-organisation, notamment au travers d’une écologie de l’action. Or ici, en effet, s’adapter ne signifie pas composer en fonction de ce qui est déjà, mais bien davantage faire en fonction de ce qui risque de survenir. Autrement dit, l’adaptation en son sens complexe, suppose la capacité de s’adapter, ce qui signifie encore la capacité de l’adaptation de soi tout comme la capacité de l’adaptation à soi. Approche qui permet d’insister sur un aspect important, le caractère imprévisible et aléatoire de toute attitude adaptative propre au vivant : s’adapter signifie l’aptitude à s’adapter aux aléas et aux changements[10], d’où également la dimension praxique et stratégique de l’adaptation, notion qui elle-même est vouée à se transformer en fonction des aléas[11].
La pensée complexe de la vie se déploie donc en un mouvement double, un mouvement contradictoire et complémentaire. Il s’agirait d’un côté d’envisager la nature en ce qu’elle a de positive, créative, et sans doute « maternelle, harmonieuse »[12], face à une nature qui serait impitoyable, sélective, éliminatrice. Ces deux conceptions – renvoyant successivement à Rousseau et à Darwin – sont rendues compatibles en un même système selon le principe d’éco-organisation, constituant alors ce qu’on pourrait nommer, la dialogique de la nature. L’éco-organisation est par la suite généralisée pour s’étendre à tout système vivant, communicatif, associatif, évolutif, et diversifié. Il s’agit donc de s’accorder aussi bien à propos des sociétés, qu’à propos des idées, qui aussi se développent et se régénèrent, formant ainsi un système tout autant éco-organisé. Cette capacité qu’a le principe d’éco-organisation à se retrouver dans des domaines a priori externes, résulte de l’application de ce que Morin nomme un regard écologique, consistant à « percevoir tout phénomène autonome (auto-organisateur, auto-producteur, auto-déterminé, etc.) dans sa relation avec son environnement »[13].
Une écologie des œuvres d’art
Dès lors, de quelle façon un regard écologique peut-il être porté sur l’art ? Notre recherche ici se précise. Comment en effet articuler un principe d’éco-organisation, à la question esthétique ? Si le regard écologique signifie l’adaptation d’une logique écologique à tout système, sans doute peut-on explorer une première voie esthétique, en ce que les œuvres d’art forment elles-mêmes un système autonome et en relation avec un « environnement ». En cela, et au même titre qu’il semble possible d’envisager une écologie des idées comme le fait Edgar Morin[14], nous pouvons assurément envisager une écologie des œuvres d’art, pourvu que ces dernières soient comprises à la fois dans une relative autonomie, dans leur fermeture, tout en étant reliées les unes aux autres, c’est-à-dire dans leur ouverture. Or jusqu’où peut-on ainsi dire que les œuvres d’art jouissent de certaines propriétés du phénomène de la vie ?
Ainsi, à propos des idées, Morin écrit : « les idéologies, mythes, dieux cessent d’apparaître comme des ‘produits’ fabriqués par l’esprit humain et la culture. Ils deviennent des entités nourries de vie par l’esprit humain et la culture, qui constituent ainsi leur éco-système coorganisateur et coproducteur. »[15] Ici, il s’agirait donc de comprendre, à partir de l’écologie des idées que formule Morin, de quelle façon une œuvre d’art prend vie. Pour cela, Morin précise que prise isolément, l’idée (l’œuvre d’art) est apparemment dépourvue de vie. Il lui faut davantage se déployer en fonction de la chaîne dans laquelle elle s’insère : c’est le contexte, la situation et le milieu qui lui donne une certaine « organicité »[16]. En conséquence, donc, s’il y a lieu d’envisager une écologie des œuvres d’art, c’est dans la mesure où les œuvres forment un système et se renvoient les unes aux autres, formant une entité organisationnelle « vivante »[17], en cela qu’elles suscitent contradiction, autonomie, complémentarité, échappant tantôt à celui qui les conçoit, prospérant dans les êtres et les esprits, se nourrissant d’eux tout comme elles s’en nourrissent. Les œuvres d’art ont quelque chose de vivant puisqu’elles s’inscrivent dans un mouvement plus vaste d’interactions et de rétroactions constituant tout écosystème[18]. Chaque œuvre d’art semble se lire dans sa dépendance à l’ensemble des autres œuvres d’art, dans un rapport de solidarité.
Cependant, en elle-même, à l’échelle de l’œuvre et non plus dans son rapport aux autres, l’œuvre peut aussi être considérée selon une logique du vivant en ce qu’elle s’inscrit dans le principe de l’autos. Ainsi, parfois, les idées naissent, vivent et meurent, probablement tout comme les œuvres d’art. Bien que les œuvres ne soient pas des idées, (à prendre au sens large nous précise Morin, comme ce qui réunit théorie, philosophie, idéologie), il faut croire que leur création, et leur mise au contact du monde qui les entoure, exerce sur les idées (ou les œuvres), la pression d’une présence extérieure, celle d’un monde environnant entraînant la nécessité de s’adapter et de s’organiser en conséquence. Surtout, les œuvres ou les idées prises une à une jouissent d’une force interne, d’une pulsion de vie qui les porte et les transporte vers une relative consistance, une relative autonomie lui donnant sa qualité, son éloquence, sa force. L’autos signifie que tout être vivant est invité à prendre conscience de lui-même, il se clôt, tandis que l’oikos suppose que tout être vivant soit inséré dans un ensemble plus vaste avec lequel il interagit et où il s’adapte. Puisque tout être vivant est à la fois autos et oikos, il est donc auto-éco-organisé : c’est-à-dire qu’il est tourné à la fois vers lui-même, et vers le monde qui l’entoure. C’est cette particularité finale, la contradiction et la complémentarité qu’admettent l’autos et l’oikos, particularité propre à tout être vivant qu’il nous faut interroger.
La pensée complexe permet de penser le lien entre l’organisation et la désorganisation, entre l’ordre et le désordre, ce qui nous aide à comprendre la vie à la fois comme un affaissement, une décrépitude, là où elle envisage l’émergence de toute chose, en accord avec l’esprit du devenir.
Vie et mort de la vie
La vie se pense de façon duale, dans ses ambiguïtés, rappelant déjà ce que nous disait Héraclite : « vivre de mort, mourir de vie » ; on garde également à l’esprit la célèbre phrase de Xavier Bichat, disant que « la vie est l’ensemble des fonctions s’opposant à la mort »[19], pour conserver cette idée selon laquelle, penser la vie est aussi comprendre ce qu’elle n’est absolument pas. Il faut concevoir le principe « décadent », selon le terme de Schrödinger[20], comme un aspect intégralement constitutif du principe de la vie, nécessitant que l’on saisisse la dualité avec la mort, non comme la distinction de deux forces hermétiques l’une à l’autre. Il faut croire bien au contraire que la mort constitue tout autant l’une des dynamiques essentielles à la vie. C’est aussi ce qu’implique la complexité, comme nous le rappelle Edgar Morin : « nos organismes ne vivent que par leur travail incessant au cours duquel se dégradent les molécules de nos cellules. […] En quelque sorte, vivre, c’est sans cesse mourir et se rajeunir. »[21].
Or, c’est précisément en tenant compte de cette tension entre ce qui devient obsolète, et ce qui émerge comme nouveau paradigme, que nous pouvons renvoyer de façon écologique, aux principes de la vie. Ainsi sans doute est-ce à l’aune de cette contraction avec la « non-vie » qu’il faut appréhender le régime écologique des œuvres d’art. D’où également la nécessité d’envisager, la figure de l’hybride, du transverse, tout comme celle du monstre, en ce qu’il « manifeste en effet, la précarité de la vie et l’inquiète du dedans », selon les mots de Marion Zilio [22], ce qui ne manque pas de nous rappeler en définitive, combien l’idée de la dégénérescence occupe une place entière dans les arts, comme nous l’enseignait par ailleurs les travaux du Land Art, animés de forces entropiques.
Le travail de la décomposition est concomitant avec le travail du développement dans l’ordre du biologique, et cet aspect est clairement exemplifié dans l’œuvre de Michel Blazy, figurant le vivant en laissant s’accomplir les forces naturelles, comme lorsqu’il peuple des espaces de véritables vivariums, ou qu’il dispose certaines matières organiques en vue d’assister à leur décomposition (fruits, biscuits, pâtes, légumes…). Michel Blazy semble exceller dans la mise en place d’un art du vivant, puisqu’il en intègre les principes les plus fondamentaux. Comme le relève Christine Macel, « C’est la fluence dans ses deux mouvements contradictoires et la possibilité d’une concrescence, qui intéressent Blazy. […] Blazy s’attache au processus de l’altération, au changement d’état, au passage d’un état à un autre. Blazy cultive à la fois la génération et la corruption qui ne sont que des cas particuliers de l’altération »[23].
Une œuvre comme celle des Choco-poules, présentée à la Maréchalerie de Versailles, consiste en une installation dans laquelle on peut y voir sur un canapé et une télévision dissimulés sous un drap blanc, trois poules en chocolat. Tandis que le grand drapé figure l’absence comme nous le rappelle l’artiste – puisque c’est ce que l’on fait lorsque les gens sont morts ou absents[24]–, ces poules en chocolat s’avèrent au contraire animées de vie car elles sont saisies dans l’action de picorer. Elles ont cependant l’apparence de poules calcinées, cuites, comme des « canards laqués »[25] , et se retrouvent ainsi saisies dans une étrange dualité : là où le chocolat suppose le plaisir, les poules restent des animaux domestiquées à grande échelle pour des fins alimentaires. Outre le rapport essentiellement dialogique de ce que met en œuvre Blazy, on retient ici l’importance de figurer par l’ambivalence et le jeu des contraires, un certain rapport à la résistance, comme il aime à le rappeler. Toutefois, des œuvres s’attachant à investir les processus contradictoires de la vie ne sont pas forcément celles qui investissent le champ de l’organique. Que l’on songe notamment à ce que permettent des pratiques qui s’emploient à mettre en œuvre des principes liés à la cybernétique, à la vie artificielle, mais surtout à la synthèse de l’intelligence artificielle, dans sa nécessité d’élaborer une pensée auto-éco-organisationnelle. La nécessité d’envisager le traitement de l’information de façon dialogique impose enfin un lien à l’égard de la communication, telle que développée par l’école de Palo Alto ; ce qui en outre évoque les travaux de l’Art sociologique, ou Esthétique de la communication, renvoyant en cela à un art se préoccupant d’une certaine forme d’intelligence collective, mais surtout à l’idée d’immersion et de participation. Dans l’optique d’inclure le tout et les parties, d’assimiler l’objet au sujet, la complexité permet précisément de penser des pratiques contemporaines ouvrant l’art à d’autres perspectives.
Esthétique et non-art
Cependant, peut-on imaginer des œuvres qui dans leur rapport écologique, seraient à la fois tournées vers elles-mêmes, tout en étant ouvertes vers l’extérieur ? Est-il possible de comprendre les œuvres d’art, en ce qu’elles sont fermées et ouvertes ? Oui, dans la mesure où l’œuvre semble faire écho à un double désir. Celui en premier lieu visant à l’édifier en tant qu’œuvre, se saisissant des principes d’individualité, de singularité et d’originalité – principes qu’il faut par ailleurs interroger au regard des idéologies modernistes – et, en second lieu, celui visant à l’insérer de façon cohérente au regard des autres œuvres existantes, dans le présent inévitablement, dans le passé évidemment, et dans le futur probablement.
Dès lors, l’œuvre d’art est à la fois ouverture et fermeture, dans la mesure où elle n’est œuvre qu’en s’ouvrant à d’autres œuvres, alors qu’elle n’est œuvre qu’en se considérant différente des autres œuvres. Aspirant à la fois à l’identité et à une intégration que l’on pourrait qualifier de sociale, l’œuvre d’art entre tout à fait dans le dispositif d’auto-éco-organisation le rapportant au monde des êtres vivants.
Or l’œuvre saisie d’un double désir est aussi une œuvre ancrée dans une double temporalité, dans son oscillation entre ce qu’elle est (déjà), et ce qu’elle n’est pas (encore). Hésitant entre l’être, le « il y a » de l’ouverture et le non-être, le « il n’y a pas » de la fermeture, on notera comme le fait Christine Buci-Glucksmann que cette hésitation, cette articulation correspond au temps intermédiaire du passage et de l’entre-deux, au temps de l’éphémère[26]. Or la vie serait ce qui jouirait de cette double temporalité que signifie le passage et le devenir liés à la Physis, ce qui nous indique également que l’esthétique, que toute esthétique se doit de prendre en compte cette temporalité « vitaliste » articulant ouverture et fermeture. Toute esthétique serait en définitive marquée par le sceau du vitalisme, si on entend par vitalisme l’expression duelle de la contradiction et de la complémentarité telle que Morin l’énonce, faisant de l’esthétique l’horizon même dans lequel s’épanche la pensée complexe. Jacques Rancière écrit par exemple que « La politique de l’art dans le régime esthétique de l’art, ou plutôt sa métapolitique, est déterminée par ce paradoxe fondateur : dans ce régime, l’art est de l’art pour autant qu’il est aussi du non-art, autre chose que de l’art » [27]. L’art dans le non-art n’empêche alors pas la comparaison avec la vie proliférante qui simultanément est vouée à décrépir pour perdurer. Ceci d’autant plus que le rapport que l’art éprouve à l’égard du non-art est lui aussi un rapport créatif et adaptatif.
Une telle esthétique permet de penser son cadre « épistémologique » à l’aune de ses contradictions créatrices, non tant dans la circonscription disciplinaire à laquelle est cantonnée toute « méthode » scientifique, mais dans la possibilité qu’elle a de continuellement laisser germer quelque chose de nouveau, lorsqu’en définitive, cela peut supposer également l’obsolescence d’anciennes pratiques comme on le voit dans l’histoire de l’art. Tout comme pour la vie, la possibilité du nouveau émerge d’une praxis écologique, d’une sorte de jeu entre chacune de ses composantes, là où le jeu suppose l’articulation, la computation, la dialogique entre l’être et le non-être, entre l’art et le non-art.
Conclusion et ouverture : du nouveau
Nourri de deux élans, l’esthétique « praxique », vitaliste, et en définitive, complexe, emprunte les mécanismes les plus essentiels de la vie, à savoir la contradiction et la complémentarité, dans une logique de l’incertain et en prise sur l’action. Là où le jeu de la contradiction complémentaire demeure fondamentalement créateur et adaptatif, laissant sans doute augurer une question beaucoup plus fondamentale, en s’adressant davantage à la raison d’être et à la façon avec laquelle les œuvres d’art s’inscrivent dans le monde. En effet, la création et l’adaptabilité met en exergue la considération d’une certaine temporalité du surgissement de l’être vivant, et donc de l’œuvre, en tant qu’elle est le fruit d’un acte d’invention, novateur, tandis qu’elle s’insère dans un dispositif disposé à l’accueillir, et donc n’est pas si nouvelle que cela. En fin de compte, on se rendra compte que la notion de nouveau est le pont entre une approche culturelle de l’art, et une approche « vitale », au sens ici déployé.
Ainsi, rapporté au monde des arts, la pensée complexe semble interroger l’ambivalence entre tradition et nouveauté, ou plus précisément les conditions de la production du nouveau. Comprenant cette notion dans le cas des œuvres d’art comme une question éminemment culturelle, il est intéressant d’interroger les modalités de sa genèse à l’aune de ce que permet la pensée complexe. En exemple, la question des avant-gardes qui évoque la nécessité de s’émanciper à l’égard d’une certaine tradition, tout en étant dans le même temps repris pour forger une « nouvelle tradition ». Ce qui de surcroît ne manque pas de rappeler l’assimilation du non-art par l’art évoqué avec Rancière.
Une esthétique vitaliste pourrait avoir pour interrogation essentielle la genèse du nouveau. Si ce dernier semble être un fait culturel par excellence – en particulier à propos du modernisme artistique –, il s’agit pourtant de la « vertu suprême de l’éco-organisation »[28] comme nous le rappelle Edgar Morin. Conception qui nous renvoie d’emblée du côté des mécanismes de la vie, comme si vie et culture nouaient une réciprocité aussi inéluctable que créatrice. On perçoit alors qu’approchant la notion de vie, les perspectives à l’égard de l’esthétique restent sans cesse nombreuses et ouvertes, mettant d’une part un terme aux conceptions selon lesquelles il y aurait une « fin », et d’autre part, rendant d’autant plus nécessaire une interrogation à propos de la contemporanéité de cette esthétique, en cela même qu’elle semble toujours nouvelle.
[1] Edgar Morin, La Méthode 2. La vie de la vie, Paris, Le Seuil, 1980.
[2] Jean Tellez, La pensée tourbillonnaire, Paris, Germina, 2009, p. 82.
[3] Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Le Seuil, 2005, « Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. […] La complexité ne saurait être quelque chose qui se définirait de façon simple et prendrait la place de la simplicité. La complexité est un mot problème et non un mot solution. », p. 10.
[4] Edgar Morin, La Méthode 2, op. cit., p.28.
[5] Ibid., p. 29.
[6] Ibid., p. 19.
[7] Edgar Morin, La Méthode 1. La nature de la nature. Paris, Le Seuil, 1977.
[8] Jean Tellez, op. cit., p. 116.
[9] Edgar Morin, La Méthode 2, op. cit., p.35.
[10] Ibid., p. 48.
[11] Ibid., p. 49.
[12] Ibid., p. 57.
[13] Ibid., p.78.
[14] Ibid., p. 84, Voir également La Méthode 4. Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Le Seuil, 1995.
[15] Ibid.
[16] Ibid., « Nous savons qu’un mot dans le dictionnaire est multivalent, qu’il a potentiellement plusieurs sens très divers, et qu’il ne prend son sens que dans le texte du discours qui l’enchaîne et qu’il enchaîne. […] Ainsi le contexte est en fait l’écotexte coorganiteur de tout mot, toute idée. »
[17] Ibid., p. 85.
[18] Jean Tellez, op. cit., p.111.
[19] Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et sur la mort, Paris, Flammarion, 1994.
[20] Ervin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie?, op. cit., p. 170.
[21] Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, op. cit., p. 85.
[22] Voir dans cet ouvrage le texte de Marion Zilio « Vie et contingence, l’effort d’une attitude ambivalente ».
[23]Christine Macel, Le temps pris. Le temps de l’œuvre et le temps à l’œuvre, Paris, Monografik Editions, Editions du Centre Pompidou, 2008, p. 87.
[24] Michel Blazy, « Un observateur du vivant », propos recueillis par Boris Daireaux, www.evene.fr, 2006.
[25] Ibid.
[26] Christine Buci-Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, Paris, Galilée, p. 12.
[27] Ibid., p. 53.
[28] Edgar Morin, La Méthode 2, op. cit., p. 35.